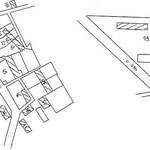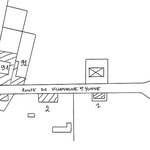Article de l'Yonne Républicaine du 28/07/81

Le Livre de Fernand Drion : Egriselles le Bocage
Mon village au début du XXème siècle raconté maison par maison, commencé par l’est, coté sud, le 29 août 1977.
1ère maison : construite en 1867 par et pour le Maconnais compagnon du tour, qui fut un grand oncle de ma femme. Le second propriétaire, JAMBON Jean-Joseph Alexis, dit Jules, mort en 1940, ne fut jamais un travailleur passionné. Il fut crieur dans les ventes (ou guelard pour la plus part). Il possédait environ 30 ares de vignes et était souvent dedans, le crochet sur l’épaule. Il était spécialiste de l’asperge et du cidre de qualité dans lequel il n’entrait aucun fruit avarié. Maison aujourd’hui à Monsieur BIANCHI.
2ème maison : ferme construite en 1865 pour mon grand père ROGER Victor qui l’occupa en mars 1866. Ma mère avait deux mois. Il n’y avait qu’un seul corps de bâtiment, la suite vint petit à petit jusqu’à nos jours. Mon grand père cultivateur avait un cheval, par la suite mon père, DRION Arthur en eut deux et trois. Moi, à compter de 1921 en eut trois puis quatre jusqu’au premier tracteur en 1949.
Aujourd’hui mon garçon Marcel a trois tracteurs, plus un vieux Renault spécial pour le fumier. Je ne voudrais pas quitter sans faire la comparaison des différents modes de battage de ces 80 dernières années. Cela commença par le poinçon[1], couché sur lequel s’abattait la sécoprise par le pied et par poignées, on tapait le plus fort possible. Cela sautait partout. Puis ce fut le fléau composé d’une botte grosse comme le bras, longue d’environ 70 centimètres, emmanchée par articulation au bout d’un manche d’environ 1m70. Quand deux ouvriers travaillaient de concert cela égayait les jours d’hiver, bien que cela puisse paraître bizarre j’ai battu fléau (fléiau ou fiau en patois). Après ce fut la raquette ressemblant aux coccinelles de la route de 1975. Moins large, environ extérieurement 80 à 90 centimètres, le batteur était un cylindre muni d’argots gros comme le doigt s’entremêlant avec ceux du contre-batteur. On engrainait la récolte en long et tout tombait au pied de la machine. La notre était perfectionnée, elle avait deux secoueurs de 1m70 qui faisaient tomber la paille plus loin. Les premières se tournaient à la main, la notre avait l’appui d’un manège propulsé par un cheval ou deux. Vers le début du siècle apparurent les premières machines à grand travail, mues par une locomobile[2], ces machines hautement valables n’eurent pas de grandes transformations jusqu’à nos jours sauf adaptation de différents outils, lieurs expulseurs etc. Le responsable de cette machine travaillait à Egriselles selon la tête du client, aussi plusieurs fermiers la délaissèrent pour acheter une nouvelle petite machine qui eut sa vague principalement dans l’Yonne et l’Aube vers 1905. C’était la tripoteuse mue par le poids d’un cheval sur un tapis roulant, cela occupait 4 à 5 hommes qui de ce fait, étaient occupés les jours d’hiver. Les ouvriers de culture étaient embauchés à l’année en deux termes de St Jean (24 juin) à St Martin (11 novembre) et de St Martin à St Jean. Ils gagnaient les mois d’été environ de 650 à 800 francs maximum pour l’année étant entendu qu’ils étaient nourris et logés. Ces prix étaient valables pour les charretiers[3].
3ème maison : une grange appartenant à MOUTARDIER qui était bourrelier[4]. Il la louait à l’époque avec un lot de terres à RIGOLLET Valentin, cultivateur aux Gaillards qui y engrangeait ses avoines. Il les battait au fléau les jours d’hiver aidé de son fils nommé également Valentin. Il fut tué au cours de la guerre de 1914. Vers 1920 fut construit au pignon ouest, un logement pour Alfred CHARPENTIER, occupé aujourd’hui par son fils Henri.
4ème maison (CP n° 9) : l’école, dite l’école des filles. À cette époque il n’y avait pas de gémination[5], elle était bordée coté couchant par la mare des Ragoberts. La 1ère institutrice que je connus vers 1901 ou 1902, était Melle BARBESOL avec les grandes filles, il y avait déjà deux classes. Peu après ce fut Melle BICHON qui se maria vite et devint Mme JOSEPH. Elle resta peu et fut remplacée par Melle SERRE Lucence qui venait d’Asquins près d’Avallon, un sacré bond géographique. Elle resta jusqu’à la retraite. Après elle, de nombreuses sont passées et aujourd’hui Madame JACQUES occupe le poste. Les jeunes furent éduqués par Melle Marthe BOYER pendant au moins 30 ans. Elle n’habitat jamais le logement et venait tous les jours d’Ogny où son frère était installé comme docteur.
5ème maison (CP n° 2): la maison suivante, celle de Monsieur DURAND Jules, quincaillier chauffagiste à Paris, fut construite en 1900. Il y logeait avec sa femme et sa sœur, gens tranquilles. Sa femme était la tante de MOREAU Emile, qui habitat la maison beaucoup plus tard. Aujourd’hui c’est la propriété de Monsieur MULTON gendre de Monsieur MOREAU.
Je ne peux résister au plaisir de raconter une anecdote. Monsieur et Madame DURAND avaient une blanchisseuse Madame MOUZARD. Elle emportait le linge sale et le rapportait sec et repassé. Celle-ci qui économisait sur tout, ne pouvait leur rendre tout de suite. Elle lavait les chemises et lorsqu’elles étaient sèches, le père MUZARD qui était charron[6], les mettait une semaine et sa femme recommençait le processus et les rendait à son propriétaire. Il se passait alors une quinzaine de jours et le roulement était établi, par contre pour les draps il fallait un mois. Ce fait était connu de tous les voisins.
6ème maison : La ferme de mon grand oncle Simon ROGER, oncle de mon grand père sans grande différence d’age. Il fut maire de la commune en 1870. Marié à une demoiselle PAROUX, il fut veuf sans enfant assez jeune. C’était un homme d’une grande simplicité et d’un esprit d’équité exemplaire. Mon instituteur Monsieur GAUTHEROT, au cours des leçons d’instruction civique le qualifiait de conciliateur et qualifié pour rendre justice dans tous les différents pouvant opposer les habitants de la commune. Il avait le sens du social et un esprit de famille très poussé, je cite un exemple. N’ayant pas eu d’enfant, il avait cinq neveux : d’une part mon grand père Victor ROGER, son frère Pierre-Auguste et sa sœur Apolline, enfants de son frère Pierre, et d’autre part deux filles, enfants de son frère Louis, Léocardie épouse de DARDE Victor et Zoé Edda épouse de PRIMAULT à Ogny. Etant plutôt frugal dans sa vie, il ne mangeait de la galette que les jours de fête. On les portait cuire chez mon grand père qui faisait deux fournées. Ajouter à celles de mes grands parents et celles des voisins, cela faisait un contingent important. Je me rappelle très bien ces samedis veilles de fêtes, tout le monde était gai car ma grand-mère faisait cuire à la flamme une galette faite de farine additionnée de crème. Elle était mise au milieu des flammes, cuite en vitesse avec partout des taches noires occasionnées sans doute par l’apport de crème. On la mangeait brûlante et l’on buvait un verre de cidre. C’était le prélude à la fête.
Menant cette vie simple et ayant d’assez bons revenus, il lui arrivait d’avoir des disponibilités et il ne théorisait pas alors à ce moment là. Il convoquait ses cinq neveux et selon la somme dont il disposait, faisait des tas de 300, 400 ou 500 francs et plus, et leur attribuait chacun un. Un jour, Léocardie pour ne pas la nommer, lui fit remarquer que le partage n’était pas juste car elles étaient les deux nièces d’une branche alors qu’en face ils étaient trois d’une autre branche. Mettant en pratique son esprit de justice, il lui répondit : « Je n‘ai pas d’enfants, j’ai cinq neveux que je considère comme mes cinq enfants, en conséquence je considère ma façon d’agir comme très juste ». Cela valait la peine d’être rapporté.
Les sommes partagées étaient loin d’être négligeables et ce fait n’était pas commun dans la vie courante surtout au début du siècle. En 1870 lorsque les allemands arrivèrent à Egriselles, ils le convoquèrent comme responsable de leur tranquillité, et lui demandèrent s’il y avait des francs-tireurs dans la région. Il répondit qu’il n’en connaissait pas. Il y en avait à Courtenay qui avertis, se mirent en route pour venir les attaquer dans l’église ou ils étaient cantonnés. Mais ceux-ci avaient placés des sentinelles qui donnèrent l’alarme. Ce fut la bagarre et une dizaine de franc-tireurs y laissèrent leur vie. Entendant la fusillade, mon oncle Simon comprit que pour lui il n’y avait qu’une issue : la fuite. Il partit emportant dans ses bras sa femme malade et se réfugia à la Polliotrie, hameau perdu à environ quatre kilomètres d’Egriselles. La bataille terminée, les allemands se présentèrent chez lui et furieux, ils menacèrent de brûler le village. Alors un jeune prêtre, l’abbé HORSON (qui fut par la suite longtemps doyen de Villeneuve sur Yonne), offrit sa vie en échange du village. Les allemands lui accordèrent la vie sauve.
Aujourd’hui cette ferme est partagée en trois : coté ouest elle est occupée par CHARPENTIER plombier, le milieu est occupé par CHARPENTIER André, retraité, et depuis le premier mai, coté est, les remplaçants des BALLAGUET.
7ème maison : la maison où est né mon grand père Victor, qui avant 1900, était le lieu de travail des ânes des BARON qui furent bouchers à Egriselles comme leurs ancêtres. J’ai d’ailleurs connu la mère BARON, décédée en janvier 1922.
La maison fut partagée en deux. La partie Est, est occupée par Monsieur BOULLAUD, qui exploitait un petit lot de terres. Elle fut vendue par la suite à PEPIN, maçon qui eut six enfants, quatre filles et deux garçons. L’aîné classe 1911, fut tué par la résistance en 1943. Le second classe 1917, fut tué à la guerre de 1914-18. Aujourd’hui cette maison est la propriété de BRISSOT, également maçon.
8ème maison : La partie ouest de la maison fut la propriété de mon grand oncle Auguste ROGER, puis elle fut vendue à Dominique MERCIER, sabotier qui eut à certains moments deux ouvriers. Le samedi soir et le dimanche, il coupait les chevaux pendant que sa femme Marie DIONNE, rasait les clients. Ils avaient quatre enfants. Après plusieurs ventes, la maison est devenue l’épicerie DERVIN, avant d’être supprimée et habitée par les propriétaires retraités.
9ème maison (CP n° 6) : un immeuble important, propriété d’Alfred COSSET qui possédait par ailleurs, la ferme de Serbois(CP n° 14) . Il était marchand d’engrais, agent d’assurances à la mutuelle du Mans et vigneron.
La partie « Est » de l’immeuble un café hôtel, était gérée par Monsieur CHAUSSY qui avait un garçon, Fernand plus âgé que moi de trois ans. En 1902 il vendit son fond à un boulanger d’à coté, FASSIER Charles, qui avait trois enfants : Juliette, Maurice et Jeanne. Sa femme était avenante et bien faite pour ce métier. Je me rappelle des noces qui se firent en cette période (1902-1910), presque chaque semaine. Le mercredi il y avait le marché, alors un garçon d’écurie venait s’occuper des chevaux tandis que leurs maîtres garnissaient le café. Ce tenancier fut remplacé vers 1909 par un cuisiner professionnel, DELION Emile, père de cinq enfants. Ce fut la période faste pour l’hôtellerie, le café et le bal. Depuis qu’il a quitté le métier en 1923, aucun nom n’a marqué son passage. Il est actuellement géré par GAUDEFROI qui est plutôt du genre farfelu.
Dans la partie ouest, logeait le propriétaire au rez-de-chaussée. Au dessus, avant 1900, il y avait une salle de bal dont personne ici ne se rappelle. J’y suis allé en 1898 ou 1899, un jour de foire du 18 mai, la plus importante de l’année. Il y avait bal en matinée, et ma mère devant voir quelqu’un m’entraîna à sa suite. Une nouvelle salle de bal fut construite dans la cour avec en dessous une écurie d’une dizaine de places pour loger les chevaux des voyageurs de commerce, qui se donnaient le mot pour la pension, lorsque DELION fut le propriétaire gérant de l’hôtel. Les jours de marché, un garçon d’écurie était attaché à l’établissement car l’écurie se trouvait pleine en cette occasion. Lorsque la salle de bal ancienne fut supprimée, le propriétaire en fit un logement pour son fils qui ayant fait ses études de médecine vint s’installer à Egriselles. Premier médecin au bourg, Alfred COSSET, avait l’age de ma mère et tous deux se tutoyaient.
Plusieurs médecins se succédèrent pour arriver jusqu’à nos jours : le docteur SERFATY (1908-1914), le docteur BARAILLE un bordelais, le docteur ABADIR en 1940, un égyptien très qualifié. Enfin le docteur DOROTTE, toujours établi à Sens et actuellement le docteur MORENO qui soutient bien la comparaison avec les précédents. Aujourd’hui il habite les Bruns.
10ème maison (CP n° 3 et 6) : au couchant opposé à cet immeuble une petite maison à un étage, fut occupée successivement par : DELOMOT, cordonnier qui y avait son atelier, par Monsieur MERCIER cité précédemment avec ses sabots et ses coupes de cheveux, et par le facteur CHAUDRON originaire de Chailley et MUZARD, ancien d’Indochine (la première fois), y tenait la régie[7]. Aujourd’hui c’est un maçon portugais qui occupe la maison.
11ème maison (CP n° 18) : une maison occupée par le propriétaire DELOMOT cité plus haut, qui avait déplacé son atelier. Sa femme et sa fille Germaine, toujours vivante (elle est la belle-mère de GENTIS, géomètre à Sens) se mirent à vendre de la lingerie. Lorsque la fille fut mariée à Marcel TONNELIER, le commerce se développa en mercerie et bonneterie. Vers 1910, ils élevèrent la maison d’un étage. Le gendre, Monsieur TONNELIER parti à la mobilisation en 1914, fut le premier à rentrer dans ses foyers (en octobre) avec une main en moins. Cela lui est arrivé couché dans un champ de betteraves, il n’a jamais vu d’allemands. Par la suite ces propriétaires étant allés demeurer à Sens, ils cédèrent le rez-de-chaussée à la Ruche Moderne, qui en 1919-1920 y installa un magasin d’épicerie. Le premier gérant fut Monsieur MATHE, puis les gérants se succédèrent. Aujourd’hui le magasin devenu GOULLET-TURPIN, est géré par le couple LORDONNOIS depuis 24 ans[8].
12ème maison : la boulangerie tenue jusqu’aux premières années du siècle par Charles FASSIER qui en 1902, remplaça CHAUSSY à l’hôtel la Poste. Sa boulangerie fut reprise par de jeunes boulangers, Monsieur et Madame GUILLE. En 1905, le feu dévasta le magasin à son et farines qui de ce fait, furent remis à neuf. En 1914, voulant refaire à neuf la maison d’habitation et le magasin de vente, tout l’ensemble fut abattu et remonté jusqu’au premier étage. Le 2 août 1914, la guerre vint interrompre et la reconstruction ne reprit qu’en 1919. Pendant cette période le pain était vendu en face du magasin de l’autre coté de la rue dans la maison du père COMAILLE Eustache. Il me racontait lorsque j’étais gamin la révolution de 1830 : « J’étais en prison depuis neuf mois, j’ai été libéré dans ces jours-là ». C’était sa venue au monde.
Revenons aux boulangers GUILLE. Ils eurent une fille Alice née en 1903 qui fut une grande amie de ma femme et de six mois plus âgée. Que de péripéties dans ces trois quarts de siècle ! J’avais travaillé à deux reprises comme ouvrier boulanger dans cette maison. La première fois fin 1914 et j’étais très lié avec tous. Alice, mariée à son voisin Gabriel DUPIN, tint la maison après ses parents. La guerre de 1940 fut pour eux une terrible épreuve, Gabriel mobilisé à Auxerre, dû partir plus loin. Elle partit un soir d’août 1939 avec plusieurs femmes dans son cas, voir leur mari une dernière fois. Elle avait emmené son petit garçon de 9 ans. Le lendemain à neuf heures on ne les avait pas encore revus dans le village. Le pays était bouleversé. Après de patientes recherches, on les retrouva à l’hôpital de Joigny, elles avaient au retour été victimes de collisions en chaînes, qui fit plusieurs dizaines de victimes. Alice y perdit son fils et fut elle-même gravement blessé. En 1971 elle perdit son mari et en 1976 elle périt dans un grave accident de la route. Cela faisait onze jours qu’elle avait vendu toute la propriété en viager au boulanger actuel. Celui-ci, BAUBAND[9], procède actuellement à de profondes transformations qui vont faire de la boulangerie le plus beau magasin du pays.
13ème maison (CP n° 1) : nous arrivons maintenant à la Mairie. Ce bâtiment était en 1900 un bureau de poste géré par une vieille demoiselle Melle HUCHARD. Le père ancien instituteur, avait une passion, le tournage sur bois. Avec un tour marchant au pied, il fit bon nombre de pieds de chaise, fauteuil et bureau. Je possède d’ailleurs chez moi un bureau très ouvragé, fait par le père de Gabriel DUPIN précédemment nommé. A ce sujet, une anecdote. Il y a quatre ans, un de mes camarades de classe Lucien GAY qui avait finit sa carrière enseignante comme directeur de l’école des Arts et Métiers de Cluny, et que je n’avais pas vu depuis 60 ans, s’écria en entrant chez moi : « Ca c’est un bureau de Monsieur HUCHARD ». Puis, il se présenta à ma femme qui bien entendu ne l’avait jamais vu.
Au devant du bureau de poste il y avait un appartement occupé par Madame et de Melle PAPON propriétaire de la ferme MILLON aux Brouards. La demoiselle se maria assez âgée et devint Madame BINET à Chéroy. Il y eut différents locataires et le dernier, fut Madame MANIGAULT, mère de Madame Maurice COQUILLE qui habite aujourd’hui la dernière maison sur la route de Bracy.
14ème maison : nous prenons la petite rue à gauche et nous arrivons à la maison POLLIOT. Celle-ci, avant 1900 était une forge tenue par Monsieur GUINOT, maréchal. J’ai bien connu sa femme qui avait de très grands pieds d’ailleurs assortis à sa taille. Je connus peu son mari qui remplissait le rôle de bedeau. Il se tua d’ailleurs dans l’église, étant monté en haut, le plancher céda sous ses pas et il tomba sur le sol.
Il fut remplacé à la forge par Paul RONBINARD qui au bout de quelques années se déplaça et s’installa dans la maison du père CEVIN. L’emplacement de la forge fut acquis par Alexandre POLLIOT qui exploitait sa ferme à Bracy (aujourd’hui CARRE) et se retira dans cette maison. Elle fut ensuite occupée par LATOUR soit disant horloger, puis par SAVEL chef cantonnier. Aujourd’hui cette maison est occupée par la famille ROCHEUX.
Une anecdote au sujet de la maison POLLIOT. Mon père Arthur DRION, un jour qu’il lui rendait visite, fut surpris de le trouver seul. Apres un moment, il lui demanda : « Céline est donc malade ? Je ne la vois pas. » Alexandre POLLIOT lui répondit que sa femme n’était pas malade bien qu’elle soit au lit. Il lui expliqua qu’elle avait acheté six œufs d’oie qu’une poule avait commencé à couver mais qui finalement avait abandonné. Céline s’est donc mise au lit, les œufs sous l’édredon, pour sauver la nichée. Si la première couveuse était de type Bresse, je dois dire que la seconde aurait plutôt été du type Charollais. J’ai appris par un ancien instituteur, beaucoup plus érudit que moi, que nos ancêtres employaient cette méthode dans les milieux, où certains invalides pouvaient rendre d’autres services.
15ème maison : dans la cour de la maison POLLIOT existait une maison appartenant au père PLOUIN, vigneron, journalier ou bûcheron. Il avait une vigne de 60 ares vers le bois du Pli, qu’il piochait à longueur d’année. Il emportait pour son midi, un croûton de pain, une tête d’ail et un litre de son vin. C’était en quelque sorte le ressort de sa résistance à la peine. Mais il n’était pas hélas le seul dans ce cas-là à cette époque. Aujourd’hui il reste comme descendance Madame POUTHE, son arrière petite fille habitant Champagne-sur-Seine.
16ème maison : ici nous arrivons à la maison de Nicolas MAROIS d’où est sortit la dynastie des MAROIS, exploitants forestiers et de la scierie à Domats. J’ai bien connu la mère MAROIS toujours coiffée d’un bonnet blanc. Ils eurent quatre enfants qui eurent en mariage chacun 10 ares de terre. Ce fut pour certains le noyau d’une fortune appréciable.
Cette maison fut ensuite la propriété de Madeleine COLIN, qui vieille fille se maria à un veuf GIRARD, dit le dragon, grand père des NEVET. Il se noya vers 1904 dans un puit aujourd’hui couvert, situé à gauche en entrant dans la cour du menuisier DUPUY. Madeleine COLIN était la sœur de Jules DURAND et de Monsieur MOREAU, habitants successifs de la maison (n°5).
17ème maison : la maison MOUTARDIER qui fut occupée vers 1900, par BOBARD Anatole. Celui-ci eut cinq enfants. Le premier fut une fille de mon âge, Suzanne, qui se maria avec François CONTE à Villeneuve-sur-yonne. Le plus jeune des enfants, André était mon filleul.
Lui succéda Paulin COSSET, enfant du pays, né à Ogny. Sa mère pendant son jeune age l’apportait sur son dos à l’école du pays, car il était déhanché. Elle avait un surnom, on l’appelait la mère BRULEVENT. Elle ne rigolait pas.
Lui succéda après 1940, un des ses employés MELAISNE Jean, qui tint la bourrellerie jusqu’au premier août 1977. Il gérait également un débit de tabac.
18ème maison : les maisons basses ou habitait à la fin du siècle dernier le père TELLIER, tonnelier disparu vers 1902. Le corps de bâtiment fut acheté par Justine POYER qui le loua à différents locataires : en 1910 à un facteur du nom de DREIGE, puis à PICOUET Paul, QUATRE Joseph. Aujourd’hui cette maison est la propriété de DUPUIS, menuisier.
19ème maison : de l’autre coté de la rue, une maison avec un atelier de menuiserie était la propriété du précédent TELLIER, Arsène de son prénom, qui ne l’occupa pas longtemps. Sa femme un peu extravagante le poussa à partir à Paris. Il vendit donc au père COUDERC, auvergnat marchand de tissus, qui fit construire en 1894 la gendarmerie, dont on parlera plus tard. Sa veuve, Céline RENARD, née à Piffonds, exerça au début du siècle et se retira dans cette maison. Aujourd’hui cette maison est la propriété des SEVERE[10].
20ème maison : une petite maison habitée pendant la guerre de 14-18 par un réfugié des Ardennes, ancien militaire, qui subit les sarcasmes des jeunes de l’époque. Il s’appelait le père TOUSSAINT. Cette petite maison bien améliorée aujourd’hui, est occupée par un couple de retraités, les PERROT.
21ème maison : ce grand corps de bâtiment a appartenu à la famille FOUET. Enumérer les habitants successifs serait fastidieux. Je connu la mère FOUET vers les années 1900-1902. Avec son bonnet blanc elle habitait au premier étage fenêtres du milieu. Au rez-de-chaussée coté ouest, habitait Albert LHOSTE[11]. Marié en 1908, il y installa un atelier de menuiserie, aujourd’hui toujours exploité par DUPUY, propriétaire du tout. Albert avait fait son apprentissage chez TELLIER (cité au 19). Sa femme habite toujours là avec son fils Raymond, retraité de la police, son père étant mort en 1953. Albert était un personnage dans la pays, pas mal menteur, ce qu’on lui pardonnait volontiers car ses histoires, ses réparties et sa mimique en faisait un Pagnol à la mesure du pays. Je l’ai beaucoup regretté, ainsi que nombre d’autres. Ses monologues ou démonstrations chez la Godasse (le bistrot) sont des souvenirs qui ne s’effacent pas. Je citerai pour mémoire sa première mise en bière. Etant apprenti chez TELLIER, cela se passa chez GALLOIS à Châtre vers la fin du XIXème siècle, ce fut un cirque !
22ème maison : en bordure de la rue principale, il y avait un atelier de mécanicien et une charcuterie occupant un corps de bâtiment acheté par BARON, boucher, à la veuve FOUET vers 1912(n°21). L’atelier fut géré par LATOUR (cité au n°14). Il vendait de belles et bonnes bicyclettes Bernasse, fabriquées à Toucy. J’en avais une vers 1909 qui ne me quitta jamais. Le premier tenancier en mécanique automobile fut VINOUZE après la guerre de 1914. Il vendit son fond à GERARD qui en 1974 céda à BOUCHEROT gérant actuel.
23ème maison (CP n° 5) : la charcuterie tenue à la fin du siècle précédent par BOURGOIN qui céda son fond en 1912 à GRANGE qui l’exploita jusqu’à la fin de la deuxième guerre. Le boucher voisin, FLEUROIT acheta alors le fond à GRANGE. Il mit en gérance un jeune charcutier, FROT qui avait été déporté du travail en Allemagne. Ce-ci ne fut pas à son honneur car il y apprit à faire de la charcuterie plutôt chimique. Il arrivait à faire du boudin noir sans aucune espèce de sang. Le propriétaire, FLEURIOT, confia alors la gérance à FONTENOY qui en fit une maison de grande qualité. Il céda en 1974 à un jeune charcutier, FROT (deuxième du nom), qui continue le métier dans la même renommée[12].
24ème maison (CP n° 5) : vers la fin du XIXème siècle, fut construite la boucherie « BARON Arsène » attenante à la charcuterie précédente. Je rapporte une anecdote que je tiens de mon grand-père. Lors de la guerre de 1870, les francs-tireurs venus de Courtenay (n° 6), essayèrent de mettre le feu à un gros noyer à proximité de l’église, ou étaient retranché les allemands, espérant brûler les portes de l’église. Ce noyer se trouvait à l’emplacement où fut construit la boucherie. La boucherie fut tenue par son propriétaire, BARON, jusqu’en 1909 et gérée ensuite par son fils, BARON Arsène, qui fut maire d’Egriselles en 1940. Le fond fut alors géré à cette époque par Madame FLEURIOT dont le mari était prisonnier en Allemagne. Plusieurs années après son retour, FLEURIOT céda son fond à FILLION, un jeune énergique et travailleur. Il en fit une grande maison, mais après lui hélas, divers jeunes, incapables, menèrent le fond à la banqueroute. Aujourd’hui un fond d’épicerie monté par MILACHON Gilbert, donne un peu de vie à ce coin du pays.
Madame BARON Augustine, propriétaire et femme du maire en 1940, occupe toujours un logement ici, elle a 89 ans.
25ème maison (CP n° 7) : une maison bourgeoise flanquée de deux ailes qui appartenaient avant 1900 à la famille DARDE-JUFFIN, avant qu’elle ne soit la propriété de la famille DARDE-ROGER, cousins germains de mon grand-père Victor.
A l’est, une boutique d’épicerie fut gérée par Madame DARDE-JUFFIN, puis au début du siècle par Madame veuve MAROIS qui avait deux filles, Jeanne et Yvonne, mortes jeunes. Jeanne fut marié à François MENNETEAU, le facteur. C’est lui qui découvrit le crime de Jully qui fit 5 morts en 1910. Les assassins avaient 14 et 15 ans à l’époque. Ensuite l’épicerie fut gérée par TESTE, ROUSSOLIN, GOUOT. Le dernier occupant fut Madame SERVAIS qui en vers 1935 alla s’installer plus loin.
A l’ouest une boutique de rouennerie[13] tenue vers 1900 par Paul JAMMOT, qui trinquait souvent avec ses clients à l’hôtel, mais qui commandait toujours un café. Après diverses péripéties cette boutique est occupée depuis trente ans par M GUERIN, électricien. L’ensemble de ces dépendances fut acheté vers 1972 par Bernard THOMASSIN qui exploite dans la partie « Est » un beau magasin de nouveautés et d’habillement.
26ème maison (CP n° 7) : l’hôtel du commerce où logeait autrefois le propriétaire Monsieur HULOT dont l’arrière petit fils, Monsieur SERVAIS, est actuellement sous-préfet à Sens. C’était un très bel emplacement, une belle salle de café, de bal et des chambres.
J’y connu vers 1900 Madame LAMIRAL comme gérante, puis GOURLET qui lorsqu’il partit, alla habiter Courtois où il devint maire puis conseiller d’arrondissement du canton Sens-Sud. Ensuite ce fut CHASSEL, sortit de la cambrousse qui répétait toujours des mots venus du fin fond de la Puisaye : « Qcheue par bin ». Sa femme, une grande brune bien plus jeune que lui, faisait le commerce à elle seule. Elle était courageuse et agréable.
Vint ensuite SARRAZIN Amélins, gendre de BUTTEAUX de Serbois (pas noble). Il était charcutier et sa femme Mathilde aidée d’une bonne, s’occupait de la vente. A l’heure de midi les écoliers des hameaux venaient chercher leur déjeuner. Un ou deux tranches de saucisson, et le repas était bâclé. Les jours où c’était la bonne qui servait, c’était la fête. Ma femme, Jeanne CORNU qui a un faible pour le saucisson, s’en rappelle encore. Avant 1914, il se trouvait parfois que certaines soirées se prolongeaient fort tard, dépassant l’heure réglementaire. On se réunissait dans une pièce à l’arrière qui ne laissait filtrer aucune lumière. Il y avait des gars comme moi ou plus vieux : LETOFFE, DEVAUX, JAQUEL, commis maréchal, ouvriers agricoles comme Jacques DIOT, qui est toujours là. Il y avait aussi COLAS le bossu premier clerc de notaire, et un certain Nénesse, père du maire actuel qui faisait finir la soirée au champagne. A ce moment il n’était plus question de parler de Nénesse, c’était Monsieur GOIS ! Il était très susceptible, mais cela nous coûtait peu car ses réunions étaient assez fréquentes. Par la suite après la guerre de 1914, le fond sombra et SARAZIN s’en alla tenir un bistrot à Villeneuve-sur-Yonne, rue du Grand Four. Il avait deux enfants, un garçon déficient mental, né en 1902, et une fille. Ils habitent toujours Villeneuve.
Par la suite la propriété fut achetée par le fils POLLIOT Julien, exploitant à Bracy. Il y mena une vie de demi rentier, d’un minutage extrêmement maniaque, ce qui en faisait la risée de tous. On l’appelait « En principe », un mot qu’il affectionnait et répétait sans cesse. Ses manières d’agir sont restées légendaires. Il est mort dans les champs en 1953. Sa fille Marie-louise, se maria avec un LORET de Vernoy. Mais après la mort de celui-ci par le tétanos, se mit à boire et mourut comme une pocharde en 1975. La veuve de Julien POLLIOT est décédée en 1977, et le tout revient à la petite fille Monique, mariée à un morvandiau du nom de DORLET. Ils sont donc à l’heure actuelle les propriétaires.
27ème maison : une vieille maison ayant appartenue à Melle BAUDOIN, ancienne institutrice devenue maniaque, et subissant les sarcasmes des jeunes de l’époque. À sa mort la maison fut achetée par un ancien boulanger, le père Émile ROUSSELIN, natif du pays. C’était un brave homme puisqu’en 1940, pendant la débâcle française, il reprit du service pour distribuer du pain aux gens qui évacuaient. Le jour de sa mort, à Noël, faisant ses achats chez le boucher et blaguant il disait : « On va encore faire un noël ! ». En rentrant chez lui, sa voisine, la mère RICHARD lui demanda de lui tuer un lapin. Il y alla mais ne revint pas, il tomba à coté du lapin. Ce fut son fils René qui le remplaça mais il mourut jeune. Aujourd’hui sa petite fille Renée, qui est la propriétaire, est enseignante et vient y passer ses congés. Elle a consacré sa vie aux handicapés physiques.
Il existe dans la cour un logement qui fut il y a 65 ans, au début de sa carrière, l’atelier de menuiserie d’Albert LHOSTE. Y vécut après la seconde guerre, le charcutier Désiré GRANGE (n°23). Il est actuellement occupé par Anne-Marie PAQUIER, veuve LAURENT, fille d’une famille de réfugié des Ardennes en 1914.
28ème maison (CP n° 12) : attenant à la précédente, un maison où avant 1900 était installé un sabotier et une mercerie tenus par la famille LABLE. Il y avait à cette époque deux ouvriers sabotiers dont l’un était Dominique MERCIER (n°8). La mercerie gérée par la mère LABLE avait un assortiment incroyable pour l’époque : laine, fils, dentelles, boutons, agrafes etc., que l’on ne peut trouver aujourd’hui. Il y avait par centaines, peut être par milliers des petites boites servant d’emballages. De toutes ces boites entreposées il ne restait à la fin de la journée aucune trace sur les comptoirs, car une boite sortie était toujours remise ne place d’avant d’en sortir une autre. Il y avait un dicton dans le village : « Si tu trouves pas, va chez la mère LABLE ». C’était des braves gens comme il y en avait beaucoup à cette époque. Ils n’eurent pas d’enfants si bien qu’après la guerre de 1914, toutes ces marchandises furent liquidées ce qui demanda plusieurs dimanche.
Vers 1922, la maison fut vendue à un habitant du hameau de la Rue, MANSIOT Théophile. Il vivait avec son neveu, René MANSIOT (classe 1911), prisonnier de la guerre de 1914, qui était revenu très fortement handicapé du coté des poumons. Il exerça la profession de coiffeur quelques années et décéda, ainsi que son oncle.
La maison fut achetée par Paul BARON, un voisin, qui après plusieurs locations, y installa Madame SERVAIS, épicière (n°25). Veuve avec deux filles, Lucette et Jeannine, elle vendit son fonds voici une dizaine d’années (1967). Je me rappelle une histoire drôle qu’elle me raconta. Un jour, une cliente Emma BAZIN, voulut faire des pâtes pour dîner, venant en acheter, elle lui demanda des nouilles. Le stock étant épuisé, elle lui proposa des macaronis en remplacement et lui offrit un carton de ces tuyaux de 25 cm de long. La cliente refusa prétextant qu’elle n’avait pas de casserole assez grande pour les faire cuire. Aujourd’hui on a des idées, mais elle, n’en avait pas.
Ce fond est aujourd’hui transformé en peinture, journaux, droguerie. C’est aussi varié que du temps de la mère LABLE. Il est tenu par le couple PERREAU, venus de saint Julien du Sault[14].
29ème maison (CP n° 12) : une maison bordée par l’ouest par la ruelle de Montigny. A la fin de XIXème siècle, elle était occupée par son propriétaire, Monsieur ROUSSEAU, bourrelier, dont le genre Monsieur CHAUDET était employé de la Régie à Joigny. Il vendit son fond avant 1900 à PERCHEMINIER. Celui-ci était marié à Berthe BOBARD, originaire d’Ogny. Ils eurent deux garçons. Le premier, nous l’appelions à l’école « chien blanc » car il était albinos. Le père PERCHEMINIER était un soiffard et il ne tint pas longtemps.
Il céda son fond vers 1904 à Emile MOREAU, marié à une fille de LARCHANT, qui eurent aussi deux garçons. Emile MOREAU était né aux Gaillard où sa mère demeure toujours. Comme son prédécesseur il buvait, même mieux. Je me souviens qu’un jour, CROSIER Armand lui amena une pièce de cidre de 200 litres. Il ne la descendit pas à la cave, ce qui était d’ailleurs difficile. Trois semaines plus tard elle était vide. Il avait une manière de se retrousser la moustache avec le talon de sa main, ce qui en faisait une figure de diable ébouriffée. La maison sombra ainsi que le fond.
La maison fut rachetée par Eugène DUPIN qui fut menuisier, puis épicier au pays. Il s’y retira, mais comme violoniste, continuant à animer les noces et les bals de la région. Les noces étaient pour lui et le piston qui l’accompagnait, une occasion de bien se garnir l’estomac. Etant toujours en bout de table, ils étaient bien connus des serveurs. Un jour à un mariage où j’étais invité, il fut sur le point de faire grève. Ce jour-là, en dépit du nombre d’invités importants, les plats servis ne le furent ni en quantité ni en qualité. Le bout de la table ne valut donc rien ainsi que le reste d’ailleurs. Ce souvenir le hanta toute sa vie. Après sa mort, l’immeuble fut vendu à des rapatriés du Maroc, Monsieur VOIGNIER, puis revendu à un nouvel acquéreur dont j’ignore le nom. L’immeuble est actuellement loué au personnel de l’usine Sempi[15] à Ogny.
30ème maison (CP n° 12) : passer la ruelle, se trouve un vieil immeuble qui fut longtemps la propriété de la famille ROULIN, qui étaient à l’époque de gros propriétaires terriens. Il y eut trois garçons nés au milieu du XIXème siècle. Le plus jeune, Marcel ROULIN, fut tué au cours de la guerre de 1914 où il était capitaine d’artillerie. Son nom figure sur le monument aux morts. Le deuxième garçon plus âgé, était colonel d’artillerie. Je l’ai connu au cours de ses vacances passées ici au début du siècle, mais je ne sais pas ce qu’il est devenu. Tous deux étaient propriétaires des terres de la Foret où ils firent bâtir une ferme en 1904 après que Camille MAROIS, que l’on verra plus loin, eut cesser de cultiver leurs terres. Le troisième garçon qui était docteur à Paris, était un ami de mes grands-parents. J’en ai gardé un très mauvais souvenir car au cours de ses visites, il ne manquait pas d’évoquer la santé des petits enfants. En ce qui me concerne, c’était les vers intestinaux. Il prescrivait un remède que je devais le prendre en sa présence. Lorsque par hasard, je le voyais arriver, mes parents ne me trouvaient pas facilement. Je ne sais si le remède était efficace, mais je me souviens seulement de l’amertume du produit. A l’époque il n’y avait pas de médecin à Egriselles, mais à Ogny, le docteur BOYER, enfant du pays mais pas pressé. Mes parents m’ont toujours raconté qu’à l’age de deux mois, malade à cause d’un gros rhume qui m’empêchait de respirer, ils avaient averti. Il ne vint que trois semaines plus tard. Heureusement que ça allait mieux.
Après la guerre de 1914, la maison fut louée à BOURAT Onésime, qui avait quitté sa ferme de Mongerin. Il avait une fille Germaine, mariée à un boucher de Saint Valérien, Georges BODARD. Lorsqu’ils furent disparus, la propriété fut achetée par un boucher parisien originaire du pays né en 1899, André LECOQ. Sa mère était née en face de cette maison. Autour de 1908 fut construit dans le jardin une petite maison de deux pièces que le propriétaire loue actuellement à des estivants.
31ème maison : la maison du père CUMANT qui avait une fille mariée à NAJEAN, un flic que je connus à la retraite au début du siècle. Sa condition changea car s’il n’était plus flic, il avait un gendarme à la maison, sa femme. Aussi large que longue, trois poils sur la tête, chauve ressemblant à peu à un bouledogue lorsqu’elle était assise à sa fenêtre (et elle y était souvent), les mouches ne rentraient pas. Lui très brave homme, conciliant et blagueur, posait des devinettes. Je peux raconter celle qu’il fit à MANSIOT. Après lui avoir dit bonjour sur le pas de la porte, il lui dit à brûle pourpoint : « Votre voisin n’est pas ? ». Silence. Il répète sa question, mais MANSIOT ne savait quoi lui répondre à part « Je ne sais pas ». NAJEAN s’écria : « Il n’est pas là, il est tailleur ! ». Effectivement en face habitait le tailleur CALMENI. Les NAJEAN avaient un fils déficient d’une jambe qui resta peu après leur disparition.
La maison fut vendue à Jules GREMY, agriculteur aux Brouards, qui vint se retirer ici quand il cessa d’exercer. A sa mort, la propriété passa à son fils, Marcel qui au bout de quelques années la revendit à des parisiens. Depuis trente ans, ceux-ci viennent passer tous leurs congés à Egriselles. Ce sont Monsieur et Madame LE GOFF Lefèvre qui en sont les propriétaires.
En suivant une bande de terrain conservée par Marcel GREMY, peut être constructible.
32ème maison : un immeuble qui appartenait à la fin du XIXème siècle à Théodore DESMEUZES. Issu d’une famille assez évolué pour l’époque (on le verra plus tard), il était maréchal ferrant. Je ne le connus pas en exercice. Il était marié à une cousine germaine de ma grand-mère maternelle, Eugénie VELARD. A eux deux, ils formaient un couple d’une avarie incroyable. Ils possédaient deux pièces de vignes que le mari se tuait à cultiver mais ils ne buvaient que du vin avarié. De cette manière on en consommait moins et le bon vin avait le temps de se gâter. Sur ce sujet ils étaient parfaitement d’accord. Comme sa femme était petite, on l’appelait « cousine petite ». Ce surnom n’était pas seulement employé par ma famille mais par tout le reste du village. On racontait que lorsqu’elle achetait une paire de sabots, elle les prenait deux pointures plus grandes, car lorsqu’ils étaient usés, il restait plus de bois à brûler. Ils eurent un fils, Edouard qui devint instituteur et ne revint jamais à Egriselles.
A l’est de l’immeuble, il existait un logement loué avant la guerre de 14 à un clerc de notaire, COLAS, dont il fut déjà question antérieurement.
Quand cette maison fut vendue, elle fut achetée par Adrien GRELOT, fermier à Serbois. Il l’habitat lorsque son fils, Raymond, lui succéda à la ferme. Celui-ci opéra de même lorsque son fils robert, le remplaça. Il ne vécut pas vieux et aujourd’hui c’est sa mère qui l’occupe.
33ème maison : la maison suivante, propriété de Constant MAROIS, était un presbytère entre les deux siècles. L’abbé Georges MEAUME y habitait. D’une nature revêche avec ses ouailles, il était au contraire, souriant avec les non pratiquants. Il aimait les cartes et ses jeunes partenaires, les frères GUERIN, ROUSSELIN et LHOSTE, y passaient de bonnes soirées. Il quitta le logement vers 1902 lorsque le propriétaire, ayant vendu son fond d’épicerie, voulut l’habiter. Constant MAROIS, fit monter quelques années plus tard, un premier étage par un entrepreneur de maçonnerie assez important, BENARD Célestin Constantin. Celui-ci fit de grands travaux dans le pays entre 1900 et 1914. Il avait des ouvriers qui venaient du Limousin et savait les prendre. Je me rappelle alors que j’allais à l’école, qu’ils partaient le midi vers l’hôtel de la Poste. Leur patron leur offrait l’apéritif deux ou trois fois par semaine. Pour l’achèvement de l’immeuble lorsque le crépi restait à faire, il faisait appel à des ouvriers spécialistes, des Tyroliens qui montaient sur des échafaudages volants. Ils avaient un bâtonnet, un balai de bouleau avec un manche de 20 cm et un seau de mortier liquide. Ils trempaient le balai dans le seau et frappaient sur le bâton pour projeter l’enduit sur le mur. Ils ajoutaient à l’enduit un produit teintant, soit rose, soit bleu du goût du propriétaire. Aujourd’hui il se fait des mouchetis avec une boite fermée qui est équipée d’un tambour muni d’une manivelle qui reproduit le geste de l’ouvrier d’autrefois. Cela s’appelle une tyrolienne, en souvenir sans doute des ouvriers venus de là-bas.
Constant MAROIS était mariée à Mélina POLLIOT de Bracy. C’était une femme franche, aimant bien ses semblables. Je ne puis résister aux récits de deux histoires, vécues parmi tant d’autres et authentiques, qui lui sont arrivées. Un après midi, accoudée à sa fenêtre, comme elle l’était souvent, passa Alexandre ROUSSELIN venu à l’enterrement d’un voisin. Pour lier conversation, elle lui dit : « Eh bien Alexandre, tu viens de l’enterrement ? » « Oui, lui répondit-il, mais je ne viendrai pas au tien ! ». Elle lui demanda pourquoi. Il répondit : « Parce que tu seras enterrée à l’Eglise ». Mélina ajouta : « Eh bien mon vieux Alexandre, tu seras enterrer civilement mais ça ne m’empêchera pas de te suivre ! ». Cela n’arriva pas et pour cause : ils furent enterrés le même jour. La seconde histoire, toujours accoudée à sa fenêtre, un beau matin de printemps, elle vit venir à elle partant piocher sa vigne, son voisin Jules. « Un beau temps mon Jules, le coucou va chanter ». Mais lui, n’ayant sans doute pas la même pensée bucolique, répondit : « Ils ne chanteront pas tous ! ». Elle comprit trop tard qu’elle avait fait une gaffe.
A leur mort, l’immeuble revint à leur fille, MAROIS, mariée à un nommé DURIOT, épicier en gros à Courtenay. Par la suite leur fille Jeanne DURIOT, en hérita. Elle habite à Melun. Le logement fut occupé par plusieurs chefs cantonniers. Le dernier BOUDIN qui avait rempilé pour deux ans, mourut sur le trottoir de la république à Sens.
La maison devint alors la propriété de l’archevêché et habitée par l’abbé JAOUEN qui l’occupa peu de temps car il mourut jeune. Le jour de son enterrement au moins soixante prêtres ont suivi sa dépouille. Depuis vingt ans, l’abbé BULLE habite la maison qui est redevenu un presbytère. Je crois que l’occupant est originaire du Doubs.
34ème maison : maison où vivait Gustave ROUSSELIN et sa famille à la fin du XIXème siècle. Ils n’étaient pas parents avec ceux cités précédemment. Gustave vivait là avec sa femme, Odile LONGUET, ses deux enfants, Marie et Paul, son frère simple d’esprit Pierre, et sa belle-mère, la mère LONGUET des Polliots, hameau de Cornant. Elle était la survivante d’un crime commis aux Polliots fin avril 1895. Elle fut blessée et son mari tué par un neveu descendu d’un train à la gare d’Ogny. Je possède le journal de 1896, relatant le procès. Des gens l’avaient vu passer, comme PRIMAULT Ulysse à Ogny ou HERY à Egriselles. Lors d’un passage de l’interrogatoire de cette pauvre femme, le président lui demanda si ce neveu était venu pour les voler. Elle répondit que non parce qu’ils étaient de pauvres gens, ils n’avaient que 12 francs à la maison. Le plus tragique dans cette affaire, est qu’à cette époque, cette somme pouvait les faire vivre un mois ou plus. Il y avait la vache, et le blé battu au fléau fournissait la monnaie d’échange contre de la farine au moulin. Elle servait à faire le pain tous les huit ou quinze jours.
Dans toutes les maisons d’autrefois existait un four. On ne mangeait pas de bain du boulanger. Je me rappelle avant la guerre de 1914 et même celle-ci finie, avoir fait le pain à la ferme de mes parents. On échangeait le levain avec les voisins pour l’avoir plus frais. Mon dieu que c’est loin tout ça, et pourtant c’est si proche.
Gustave ROUSSELIN était manouvrier et exploitait quelques arpents de terre à lui. Il maria sa fille à Marcel MOTUS. Ils eurent deux enfants, dont un garçon qui est actuellement pensionnaire à l’hospice de Sens. Le garçon Paul, après son retour du régiment obtint une place de facteur. À sa retraite, il vint vivre dans la maison. Après la mort de sa première femme, il se remaria avec une des ces premières amies, Jeanne BOUGAULT, divorcée de PAIN de Cornant. Il eut deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon le suivit d’assez près dans la mort et la fille habite actuellement Courtenay. Aujourd’hui l’ensemble de la propriété, coupée en deux, est occupé par des résidents secondaires, qui viendront un jour continuer la vie de ceux qui les ont précédés.
35ème maison : en montant aux Bruns, nous trouvons la maison de Romain BAZIN, marié à Emma MATIGNON. Amoureux de la terre, ils en étaient les esclaves, piochait dans les vignes des journées entières. Ils ne vivaient que pour amasser des sous et acheter, toujours acheter. Ils avaient même la réputation avant 1914 d’acheter les terres 20% plus cher que les cours pratiqués. Ils eurent deux garçons qui devinrent des adeptes du crochet à vigne, outil qu’on appelait la serfouette. Quand le second garçon, Jules, fut assez grand ils eurent un cheval qui leur permit de labourer et d’économiser un peu leur bras. A son retour du régiment, il se maria à une cousine germaine, Emma MATIGNON, qui se vantait d’avoir eu 10.000 francs en mariage. Ce qui pour l’époque, 1903, était un pactole. Il y avait à la maison quatre ou cinq vaches qui étaient nourries tout l’été par l’herbe des talus et des sous-bois coupés à la serpette. De cette manière les vaches donnaient plus de lait ce qui était absolument faux, mais cette coutume était respectée. Lorsque les époux BAZIN cessèrent d’exploiter, ils cédèrent à un jeune couple, François BRACHET et sa femme. Ils se logèrent dans la maison ROUSSELIN mais ils y restèrent peu et s’en allèrent à Saint Clément.
Pour conforter l’histoire du macaroni de Madame SERVAIS (n°28), voici une nouvelle histoire. La dite Emma BAZIN (née MATIGNON), allant au lait tous les matins chez leurs successeurs à la ferme, arriva alors que celle-ci se débarbouillait. Surprise de la voir se servir d’un savon, elle lui posa la question : « Vous allez donc en route ? ». Celle-ci lui répliqua « Eh pourquoi ? ». « Vous vous débarbouillez avec du savon ! ». Pour ces gens, c’était peut- être logique mais pour ces amoureux de l’argent, le luxe d’un savon n’était réservé qu’aux jours de fêtes. Ils faisaient un peu crasseux, surtout les jeunes BAZIN. On verra Louis le plus vieux, plus loin au cours du récit.
Le vieux père BAZIN fit construire au long de la route un deuxième logement qu’il occupa jusqu’à sa mort. Jules fut élu conseiller municipal lors des élections municipales où FILLION fut maire. Au cours de son mandat il fut constamment surveillant à la cantine scolaire durant les repas. Son autorité égalait zéro mais il en tirait un grand prestige. La fréquentation des autorités et des instituteurs le comblait d’aises. Il ne fut guère récompensé de ses peines car un jour l’instituteur me parlant de lui, me dit textuel : « BAZIN, c’est un c.. ». Il y avait sans doute une grande part de vérité mais moi qui ne le comptait pas parmi mes amis, ne me réjouit nullement de leur jugement. C’était le coup de pied de l’âme. Et cependant, un petit de bout ruban l’aurait transcendé. A leur mort, la ferme fut vendue à un voisin, MONGENET. Il vendue le petit logement aux époux PIROT, des retraités. La femme l’occupe toujours, son mari étant décédé peu après. Quant au grand bâtiment et la cour, je ne sais si les occupants actuels sont propriétaires ou locataires.
36ème maison : un immeuble qui avant 1900 était occupé par son propriétaire, MAROIS, menuisier qui mourut jeune et dont nous avons parlé de la femme épicière (n°25). A sa mort le fond de menuiserie, fut vendu à Eugène DUPIN également menuisier, qui en 1902 le revendit à un autre menuisier NAPOLEON. Après quelques années, celui-ci le vendit à HUSSENET, un enfant du hameau de Rivaux. Il y travailla jusqu’au jour de son déménagement dans un local lui appartenant à Marsangy.
Au sud de cet immeuble, vivait en 1900, un cordonnier nommé ROCHER mais on l’appelait le père « Quiribi ». Il avait deux enfants : Ernest et Eugénie. A l’age de 72 ans il se remaria un soir d’été à 19 heures à la mairie. Un fait pareil à cette époque alimenta les commentaires. Son voisin, le bedeau[16] lui fit les honneurs tout le long du parcours avec des pétards.
A l’aile l’ouest de la maison vécurent différents locataires, ROY Oscar, cantonnier, et le facteur HUOT. Ce dernier eut trois enfants, deux garçons et une fille. Le plus jeune fut déporté du travail en 1939-1945 en Allemagne. Il y mourut d’une façon tragique. Je crois qu’il est tombé accidentellement dans une cuve de métal ou d’acide en fusion. Son nom est inscrit sur le monument aux morts. Il est vrai qu’un autre, mort par suicide y figure aussi.
Il existe une rue « MICHEL Ange » au pays, encore aujourd’hui je ne sais si c’est pour récompenser une action d’éclat ou au titre d’une bienfaitrice du pays qui n’avait aucune descendance. Le cas HUOT, cité ci-dessus est pour moi d’une autre envergure, et s’il a lieu d’honorer le sacrifice, le choix doit être simple.
Plus tard la maison fut achetée par GUILLOT, un instituteur du pays qui malgré ses opinions très avancées vers la gauche, préférait investir dans le dur, d’ailleurs il le disait. Au bout de plusieurs années il la revendit à DAUDET, maçon qui l’habitat jusqu’au jour où il construit une autre demeure 300 mètres plus loin. A ce jour, la première maison, est occupée par deux locataires.
37ème maison : un hangar de la ferme MAROIS situé en face. À l’origine il était en bois mais vers 1960, il fut détruit par le feu et reconstruit en fer[17].
38ème maison : une maison construite après la guerre de 14-18, sous le régime de la loi Loucheur. Elle était la propriété d’Arnold BOUGAULT, revenu amputé d’un pied de la guerre. Il exerça la profession de facteur de bois. Son infirmité lui valut avec des protections, la légion d’honneur qu’il galvauda largement à la seconde guerre puisqu’il en fut déchu. Sa femme et lui moururent relativement jeunes, et la maison devint la propriété du plus âgé des garçons. Celui-ci vient de la revendre dans la clandestinité à des retraités dont j’apprends le nom ce matin même, LENDER. Le deuxième garçon garde-chasse, habitait les Brouards.
C’est tout pour le coté sud de la rue. Il existe simplement après une cave couverte, propriété depuis toujours de la maison d’en face.
39ème maison : repartons, ici coté nord de la rue. Je cite pour mémoire la maison sur une parcelle de Paul BOUGAULT, issue du partage des propriétés de ses parents.
40ème maison : un chemin montant vers le nord arrive à une maison ayant appartenu à la fin du XIXème siècle, au père PAROUX ancêtre des PAROUX-DESLION des Belles Maisons, hameau d’Egriselles. Je m’en rappelle très bien, ainsi que de sa femme. Tous les voisins l’appelaient de son nom de jeune fille, Manda SACCARD. Des anecdotes circulaient à son sujet mais je ne puis m’étendre là-dessus. Je peux seulement dire que même vieillie elle avait une présence.
Après eux en 1919, vint de Paris ceux que l’on poussait vers le retour à la terre à cette époque. Le couple COVETT vint manger les quelques dizaines de millier de francs qu’il possédait dans un élevage de volailles. Par la suite, la maison fut vendue à un cheminot retraité, Monsieur BORDIER. Cet homme eut une vie professionnelle exemplaire. Je l’ai eu à mon service plusieurs années. Lorsqu’il était cinq heures, le matin, il était là. Son plus grand retard pouvait être de deux minutes. En activité, il était aiguilleur. À une époque de sa carrière, son travail se trouvait à 10 kilomètres de chez lui. Il habitait Combes-la-Ville. Il me certifia que jamais son collègue ne l’attendit, la réciproque n’était pas toujours observée. Il loua plus tard la maison à Lucien GAUTHIER qui l’occupa quelques années. Ensuite elle fut vendue à un cantonnier Amour PLAISANCE, qui y vit aujourd’hui, retraité des ponts et chaussés.
41ème maison : en revenant vers la rue principale, nous trouvons l’immeuble occupé aujourd’hui par LECOMTE René. À la fin du siècle dernier, c’était la propriété de Amand FOUET. Sa fille était mariée à Arsène TELLIER (n°19). Cette femme envieuse fit vendre par son mari, la maison et les terres environnantes représentant un certain capital, pour aller à Paris, son rêve. Il s’installa comme menuisier et bien qu’étant un ouvrier qualifié et sérieux, il ne parvint pas à subvenir à tous les besoins de cette femme envieuse. Trente ans après il revint ruiné, finir ses jours avec la somme de 14 sous, dans son porte-monnaie. Sa propriété citée ci-dessus avait été vendue à Paul BOUGAULT.
42ème maison : la maison de la mère GUILLAUME. Je ne connu qu’elle. Elle avait une fille qui s’appelait Alexandrine. Elle se maria avec Paul BOUGAULT. Celui-ci venait de Piffonds. A l’époque, l’entrée de la propriété était à l’ouest, sur le chemin au nord de la propriété d’Amand FOUET. Après son mariage vers 1890, BOUGAULT acheta un matériel de battage à vapeur de la marque BROUHOT qui faisait un travail parfait. Après la guerre de 1914 il n’était nullement démodé. Par son mariage, le couple eut huit enfants échelonnés de 1890 à 1908. Ceux-ci s’égaillèrent dans l’environnement et à l’heure actuelle, il ne reste plus que le dernier né, diminué physiquement. Il habite la maison familiale. A coté, son beau-frère, le mari de Lucienne, décédée en 1975, âgé de 86 ans, y habite toujours.
Un petit garçon, Bernard BOUGAULT, garde-chasse, habite les Brouards. Je ne m’étendrai pas sur le reste de la famille.
43ème maison : la propriété contiguë était celle des GREMY, un ménage qui eut cinq enfants, deux garçons et trois filles. Je me souviens du mari, personnage un peu bizarre. Il possédait dans son grenier ce qu’il appelait son paletot, un cercueil. Il avait un surnom bizarre qui lui venait d’après mon grand-père, de sa manie de répéter ces mots : « des frites à la graisse d’âne ». Le surnom de « graisse d’âne » lui est donc resté. Il est vrai qu’à cette époque, à plusieurs voisins, on tuait aussi bien un âne qu’un cochon. Pour ma part, je me rappelle très bien à Ogny, la triplette Paulin HUSSENET, MILACHON et ROUIF, trois voisins, qui se régalaient de la mort d’un pauvre bourriquet. Le plus vieux des garçons GREMY, mourut soldat, en Afrique je crois. Le second était le père de l’occupant actuel, Monsieur GREMY, 85 ans. Une fille, Angèle GREMY, vécue toute sa vie au service de Madame MICHEL Ange. Une autre fille, devenue madame MANTELET, revint à Egriselles après avoir divorcé. Elle avait deux enfants, Jean et Maria. Je connu Jean à l’école vers 1906. Il avait sans doute l’étoffe d’un chef, car il est devenu le PDG de la célèbre fabrique du moulin légume[18] et de beaucoup d’autres dérivés. Cette maison est mondialement connue, ayant de nombreuses succursales même aux Etats Unis. Une renommée dont il se serait bien passé puisque la presse du 29 novembre 1977 révélait la menace d’un rapt sur sa personne. Il n’eut pas d’enfants, seulement un neveu né au début de juin 1924, en même temps que mon aîné Marcel. C’était le fils de sa sœur Maria. Une troisième fille GREMY était mariée à Victor ROUSSELIN, aux Brouards.
44ème maison : la maison de Camille MAROIS, construite par lui en 1904 pour l’occuper en 1905, lorsqu’il quitta sa ferme attenante. Ce fut LASSAUNIERE, maçon demeurant à côté, qui la conduisit. Aujourd’hui la propriété est à la famille BAUDOIN Joseph de Villeneuve-la-Dondagre, marié à une fille MAROIS.
Il y eut divers locataires et aujourd’hui, c’est une dentiste qui l’occupe.
45ème maison : la ferme MAROIS que Camille exploitait en même temps que les 42 hectares de la Foret. Lorsqu’il quitta, ce fut BALLAGUET Félix qui le remplaça. Sa dernière moisson fut celle de 1905. je me rappelle qu’un jour passant près de mon père, moissonnant avec une machine qu’il venait d’acheter, lui dire que si il faisait un an de plus, il en achèterais une. Ces récoltes étaient toujours très denses, car c’était un cultivateur qualifié. Ses tacherons moissonneurs ne volaient pas leur argent, ils ne travaillaient pas le vide. C’était un prix à l’arpent 42 ares. Il était d’un naturel bon vivant, et fut longtemps adjoint. Sa femme était plus âgée que lui ce qui explique peut être pourquoi il draguait dans le coin (mot qui fut inventer beaucoup plus tard).
Apres BELLAGUET qui resta quinze ans, le ferme fut reprise par BOSSERET puis GARNIER son gendre, TONNELIER et DE NYS. Aujourd’hui son arrière petite fille, née VACHET l’exploite. Elle y habita, marié à VALENTIN avec leurs quatre garçons. Au bout de trois ans, celui-ci mourut subitement. Une année après son père qui venait la soulager, est mort en dix secondes. Comme il fallait répandre du fumier, il vint chercher une machine chez mon garçon. Ne savant pas s’en servir, Marcel DRION lui demanda d’aller dans le champs et de l’attendre quelques minutes. Mais il ne voulut pas attendre, à son arrivée, Marcel le trouva mort. Voici l’explication. Il était toujours vêtu d’une canadienne à moitié boutonnée et une ceinture pendante. Se rendant compte que la machine ne fonctionnait pas bien, VACHET est descendu du tracteur sans le mettre au ralenti et s’approcha de la machine. Actionnée par un cardan, celui-ci happa la ceinture et ce fut finit. Une deuxième épreuve pour sa fille. Peu après elle se remaria avec un ouvrier qu’elle avait pris à son service. Aujourd’hui le ménage cultive les terres et fait du terrassement avec une machine adéquate. Ils eurent trois enfants, deux garçons et une fille, la seule sur sept enfants au total. Aujourd’hui ça marche bien et pour cette femme malchanceuse et courageuse, ceci doit être un réconfort après tant d’épreuves.
46ème maison : en 1900, cette propriété était habitée par LHOSTE, gendre BAUDOIN, que l’on appelait Saintonge, car étant ouvrier charpentier, il était un compagnon du tour, originaire de là-bas. Les époux LHOSTE eurent deux enfants. La fille, Albertine, était blanchisseuse comme sa mère. Le garçon, Albert était menuisier. J’ai déjà parlé de lui et de ses aventures cocasses (n°21).
Cette propriété fut ensuite achetée par un maçon, Emilien LASSAUNIERE et sa femme DAUMAS Marie. Il la transforma et y vécut jusqu’à sa mort. Ils eurent une fille, Renée, qui épousa un certain GOUGNOT et alla habiter Armes dans la Nièvre. Madame LASSAUNIERE était la sœur de Auguste DAUMAS, que nous verrons plus tard.
Ce fut ensuite DESLIONS, gendre de PAROUX Georges, qui l’acheta pour loger sa mère. Après la mort de celle-ci, la propriété fut vendue.
47ème maison : reculons au nord. Un grand corps de bâtiment est actuellement la propriété de Marcel ROULIN, exploitant agricole.
A la fin du siècle dernier, ce bâtiment était déjà la propriété de son arrière grand-père qui y habitait, exerçant la fonction de garde-champêtre. Le suivant, Arsène ROULIN, quitta cette demeure pour aller exploiter une briqueterie à Paron. Pendant son absence, la maison fut occupée par LASSAUNIERE, que nous venons de voir, puis par un cantonnier venu du Morvan, Pierre DIOT. Après la guerre de 14-18, ce fut le fils, ROULIN Albert marié à Hélène CHATON des Régipeaux, qui lancèrent l’exploitation. Puis ROULIN marié avec GODIN Alphonsine. Aujourd’hui c’est ROULIN Marcel, époux de JARENKO Hélène qui l’exploitent. Sa femme partage son temps entre l’activité agricole et le secrétariat de mairie à Marsangy. Ils ont une fille mariée qui habite Paris. Albert ROULIN, cité plus haut eut un frère René, mort pour la France.
48ème maison : en redescendant vers la grande rue, il existait une petite maison propriété de MITAIS Louis que l’on appelait le père Loulou. Il est sorti de la banalité par le fait qu’il eut 17 enfants. C’était lui qui était propriétaire de la maison dont j’ai parlé au n°46. Lorsqu’on réfléchit bien à ce qui se passe aujourd’hui sur la question de l’aide à l’enfance et que l’on compare la dite époque, on se demande si on ne rêve pas. Je veux bien admettre que certains moururent assez jeunes mais une bonne partie a atteint l’adolescence. Le père Loulou, en employant un langage imagé, ne cassait pas les traits, et j’ai souvent entendu dire mes grands parents que son vin ne sentait pas le fer. Ils voulaient dire par là qu’étant vigneron, il usait peu sa pioche pour les façons culturales. La mère Loulou que j’ai bien connue dans sa vieillesse était toujours irréprochable quand elle descendait en commission avec son panier couvert à eux anses, et sa pèlerine genre astrakan[19].
Aujourd’hui cette maison est dépendance de la ferme ROULIN.
49ème maison : ici nous nous trouvons dans le berceau de ma famille, les ROGER, dont l’ancêtre vint s’installer vers 1730. Originaire d’Ogny, le quadrilatère divisé en trois immeubles fut occupé par la descendance. Le premier qui nous intéresse fut occupé par un fils de père Loulou (MITAIS Louis), Henri, qui travaillait toujours à la campagne. Marié, il eut deux enfants, Andrée et Maurice. Celui-ci aujourd’hui retraité, acheta la maison à la famille PRIMAULT-ROGER. Maurice tempérament, froid ayant perdu sa femme vit là, plutôt effacé. Si l’on revient à son père Henri, c’est autre chose, celui-ci d’un tempérament gai, d’humeur enjouée, fit parler de lui tout au long de sa vie par ses positions pittoresques ou tragiques. Je crois qu’un cahier comme celui-ci ne serait pas de trop pour relater toutes les frasques de sa vie. Il fut tour à tour manouvrier, fossoyeur, bedeau, d’où le nom qui lui resta. Plus tard, il fut garde-chasse, emploi qui cadrait peu avec son comportement. Quand la guerre finit le 8 mai 1945, il avait souhaité prendre une cuite. Il en prit une vers les six heures de l’après midi, il l’avait, sa cuite, ne pouvant plus se tenir. Je le pris comme un gosse, et le couchai dans un landau d’enfant et comme il n’était pas grand, sa tête sortait peu d’un bout et ses pieds de l’autre, il se débattit peu car il sombra dans un sommeil profond. Accompagné de Gabriel DUPIN (le boulanger) nous le ramenâmes en musique chez lui où nous le mîmes sans ménagement dans son lit. C’est une des cent ou mille positions cocasses de sa vie mouvementée. On pourrait citer les soirées de batteuse, de cassage de noix et tant d’autres où il nous divertissait sans d’ailleurs jamais se fâcher. Il avait l’habitude de dire : « Faites moi des blagues, jamais vous n’égalerez ce que j’ai pu faire ». Henri MITAIS et Albert LHOSTE (n°21) animèrent cette première moitié du XXème siècle d’une joie de vivre que nous ne connaissons plus aujourd’hui et j’en suis triste. Il pouvait compter sur ses animateurs de bordées, les BALLAGUET, CROU, DAUMAS, PRIMAULT, de 30 à 35 ans ses cadets, car il était sûr de se réveiller dans son lit.
50ème maison : à l’intérieur de la cour, face nord, il était une vieille maison achetée vers 1900 par Louis BAZIN (n°35). C’était l’aîné des deux garçons, qui se maria également à sa cousine germaine, Lucie MAUPRONT. Ils n’étaient pas appareillés comme couple. Lui, nullement envieux, travaillait dur et son paquet de tabac fut le but de toute sa vie. Elle, elle était tout autre, physiquement surtout. Sa jeunesse aidant, elle fut la cause de biens de troubles dans le quartier. Ils vécurent peu ici, et nous les retrouverons plus tard. Ils furent remplacés par la belle-mère, Armande MAUPRONT, que les voisins appelaient Marie Charmante. Après elle, il y eut divers locataires et aujourd’hui c’est la propriété de Joseph SIMONNETTO, un maçon italien venu en France après la guerre 14-18. Il éleva trois filles et aujourd’hui à 85 ans, il jouit de sa retraite.
51ème maison : bordant la cour par le midi, un corps de bâtiment appartenait à André ROGER qui ne se maria pas. Il était comme ses trois frères, Pierre, Simon et Jean-Louis, l’oncle de mon grand-père Victor ROGER. En raison de son célibat, il eut une vie toute simple et rien de marquant ne peut-être signalé. Après lui, la maison fut occupée plusieurs années par la mère MAUPRONT que nous venons de voir. Elle était la grand-mère de Maurice MAUPRONT, jardinier pépiniériste à Bracy. Vers 1908, Célestin HUBERT venant de Paris vint l’occuper avec sa famille. Il était charpentier et y demeura jusqu’à ce qu’il se construisit une maison près des marnières de Marmotte.
Après cette époque l’immeuble fut vendu à Nicolas CHATON venu des Régipeaux où il était cultivateur. A sa mort cela revint à Albert ROULIN, son gendre qui l’habite toujours.
52ème maison : pour mémoire cette maison fut construite vers 1930 par Monsieur JOGUIET, notaire. Il s’était laissé souffler l’immeuble ou il habitait et fut obligé de déménager (n°54).
53ème maison : un immeuble neuf de quelques années, le propriétaire est Roland FONTENOY, ancien charcutier d’Egriselles, et sa femme Yvette MAROIS, originaire des Régipeaux.
54ème maison (CP n° 4) : cet immeuble fut longtemps la résidence des notaires. Vers la fin du XIXème siècle, le notaire Monsieur SIMONNET, notaire, se maria à Marie GOIS, fille du maire de l’époque. Ils n’eurent pas d’enfants, mais cependant Monsieur SIMONNET eu avec la bonne Laurence ROUILLARD, un fils à qui il fit une situation et qui devint son héritier. Le notaire était un chasseur de perdrix, étant de grande taille, il enjambait dur. A l’ouverture il fatiguait un chien le matin et un autre le soir.
L’étude fut vendue vers 1910 à Monsieur LIMOSZIN qui la géra peu. Mobilisé en 1914, il fut tué le 24 mai 1915, le jour de mes 20 ans. L’étude fut alors gérée par COLAS, le bossu. Celui-ci vieux clerc retors et même vicieux, s’en tira mieux. Je me souviens même de séances extra-notoriales auxquelles se joignait souvent Nénesse et où la morosité était absente. COLAS était friand de ces séances et lorsque celles-ci se passaient un dimanche, il n’était pas rare de le voir quitter le café vers six heures du matin, passer chez lui prendre sa serviette et partir pour la gare d’Ogny (CP n° 15) où passait un train pour Sens à 7 heures, tout cela à pied. Je me rappelle qu’un jour de neige où il eut très chaud, il était increvable et n’avait jamais de mauvais moral.
Lorsque l’étude fut vendue à Monsieur JOGUET, une fois COLAS disparu. JOGUET me dit un jour qu’il avait eu peur que COLAS ne le contre étant vieux dans le métier, il pouvait être plus fort que lui. Un jour, l’immeuble fut à vendre, et Monsieur JOGUET ne se montra pas bon tacticien car il fut évincé et obligé de construire pour se loger. C’était un vendéen, sorte de gnome barbu avec des jambes désaxées, plutôt vilain. Ma femme, Jeanne, en a conservé un amer souvenir, lorsque à la fin signature de notre contrat de mariage, il se leva et demanda le privilège d’embrasser la future épouse. De tous ces détails, il faut reconnaître une chose, il eut deux beaux enfants. Il se passe parfois des miracles ! Il vendit son étude à Monsieur PELLETIER qui avait également deux enfants.
Vers 1960 ce fut Monsieur LEFORT, aujourd’hui associé à Monsieur LOYER, notaire à Villeneuve-sur-Yonne, qui habita quelques années le pays. Aujourd’hui cette maison n’est plus qu’un bureau ouvert deux jours par semaines. Le fait qui provoqua le départ de Monsieur JOGUET, fut l’achat de l‘immeuble par Monsieur GREMY, fonctionnaire des chemins de fer. Il vint vivre sa retraite dans son pays natal (le hameau des Riveaux). A sa mort ce fut un industriel parisien, Monsieur CAZAAYOUS, qui l’acheta et fit moderniser l’intérieur. Avec sa femme, ils adoptèrent deux enfants. Ils restèrent peu d’années et la propriété fut vendue à Monsieur et Madame Pierre TISSIER, exploitants agricoles à Villeneuve-la-Dondagre.
55ème maison : deux propriétés contiguës, sans doute une seule à l’origine, étaient occupées par les frères GUERIN, Emile et Elie. Le premier, Emile, était cultivateur et vigneron comme beaucoup à cette époque. Avant 1900, il monta un début d’usine saisonnière, huilerie pour les jours d’hiver et cidrerie pour l’automne. Le reste du temps c’était la culture et la vigne. Il était fier de ses installations, cela tournait à la vapeur : une machine verticale avec une force de deux chevaux. Il se faisait souvent moquer. Je me rappelle quand nous allions faire du cidre vers les 7 heures du matin, il nous accueillait toujours aimablement. Nous connaissions le processus toujours le même : « Attention les gars, la machine est chaude ! ». Un coup de sifflet poussif, on aurait pu penser à un pneu qui expire, et ça se mettait à tordre. La râpe broyait les pommes, quant au serrage sur la maie, ce n’était plus la machine mais une chandelle verticale traversée en croix par deux espèces d’attelles que l’on mettait à l’épaule. Il n’y avait plus qu’à s’arc-bouter jusqu’à épuisement. Vers la fin il se joignait à nous et nous prodiguait ses encouragements. Je ne crois pas qu’il lui soit arrivé d’avoir des bleus à l’épaule. C’était la mouche du coche mais avec bonhomie. Pour l’huilerie c’était plus mécanique. Il faut savoir que la campagne à l’époque, fourmillait de noyers. Pour mon compte personnel, je pouvais en avoir 60 sur les terres que j’exploitais. Sur ces 60, une bonne moitié produisait peu. Quand c’était la récolte, deux mois durant, surtout après une grande pluie, c’était la corvée du ramassage. Apres séchages dans les greniers, les soirées d’hiver étaient consacrées au cassage et après au triage de l’amande. Pour ce travail, il y avait rassemblement du voisinage et surtout des jeunes. Mais ce n’était pas pour cela que le travail était mieux fait. On travaillait jusqu’à deux heures du matin, après casse-croûte, boissons et chahut. Certaines soirées sont restées célèbres. Ce qui faisait l’attrait de ces séances, c’est qu’il y avait souvent un ou plusieurs néophytes qui étaient victimes des farces montées par les anciens. Cela se passait presque toujours dans la bonne humeur. Pour ne pas trop fatiguer, on alternait les séances un jour sur deux. Quand c’était fini c’était le passage à l’huilerie. Le noyau était réduit en pâte dans le meulage, une auge circulaire où roulait une meule de grès de 1 mètres 50 de diamètre et de 0,5 de large. Puis cette pâte était mise à cuire dans une cuve sous laquelle on faisait du feu. Le temps de cuisson était déterminé par le nez de l’employé, chargé de ce travail. C’était une spécialité. La cuisson à point, on déposait en vitesse la pâte dans une presse garnie de toiles. On fermait le tout et par la force de la pression, l’huile coulait. C’était alors un plaisir de passer un doigt sous le filet d’huile et de savourer ce bon goût de noix chaude. A cette époque, on faisait une deuxième opération qui rendait peu avec les tourteaux. On faisait la première opération avec 20 kilos de noyaux d’où sortait entre 8 et 9 litres d’huile, à la deuxième cuisson, il sortait 1 litre à 1,50 litres. Entre les deux opérations, le maître de céans, pratiquait une opération qui s’apparentait à une espèce de dîme. Il démoulait les blocs de tourteaux bordés de bavures qui n’avaient pas subi toute la pression et qui étaient encore imprégnés d’huile. Il récupérait alors ces débris, qui mis de coté, contribuaient à l’alimenter personnellement en huile. Il y avait pendant les périodes de fabrication, à la sortie des écoles à onze heures, une ruée des écoliers vers l’usine pour récolter du pain de noix. Cela ne plaisait pas toujours au maître des lieux, car cela diminuait d’autant la réserve qu’il se constituait. On appelait pain de noix, cette petite partie de tourteau encore imprégné d’huile, nous en étions tous gourmands. Pour l’histoire, je signalerai que la meilleure récolte que je fis, fut de 80 litres. Ils firent fabriqués en usine moderne, chez PICOUET à Gron. Les rendements allaient de 1, 625 à 1,875 kilos pour un litre d’huile. Chez GUERIN Emile, il fallait 2 kilos et deux cuissons pour un litre d’huile.
Pour conclure, je dirais qu’Emile GUERIN eut trois enfants : une fille mariée à HEBERT, serrurier à Pont-sur-Yonne, un fils, Marcel qui exploita quelques années à Egriselles et qui fut même adjoint, et Albert qui, marié à la demoiselle CHARMEAU (la cave GRENET), se noya dans l’Yonne à Joigny. Ce fut Marcel, devenu le propriétaire, qui vendit l’ensemble à Monsieur PELLETIER, qui y installa son étude. Monsieur LEFORT lui succéda dans la place, par pour longtemps puisque la maison fut vendue à un industriel d’Etigny, Monsieur ARACHQUEME. Celui-ci en fit son domicile.
Ayant consacré près de cinq pages à ce numéro, je vais passer au suivant, les propriétaires étant frères et leur mère étant née JUFFIN.
56ème maison : maison d’Elie GUERIN, frère du précédent, fut à la fois cultivateur et boulanger. Il labourait ses terres mais ne s’occupait pas des attelages. Un journalier, ou quelques fois un arpète, travaillant à la boulangerie, lui amenait bêtes et matériels à pied d’œuvre. Je ne le connus pas boulanger et j’ai peine à croire qu’il se mettait au pétrin. Il n’était pas souple ni moralement ni physiquement. Je le vis un jour, planter des haricots habillés d’un tablier de jardinier muni d’une poche centrale contenant la semence, d’un tuyau de gouttière et d’un avant pieu avec lequel il faisait des tous. Par la suite il ajustait le tuyau sur le trou et pêchant dans sa poche, faisait couler la semence dans le tuyau. Après quoi, il comblait avec son pied pour terminer le cycle. Je vous prie de croire que je ne divague pas. Il était assez bon joueur de billard mais très lent. Avant de jouer un coup, il changeait pour le moins, quatre fois de position, visant ce qu’il pourrait faire pour finalement se décider à tenter le coup. Il eut quatre filles. Une se maria à un charcutier de Villeneuve-sur-Yonne, LECOQ. Son fils, André (n°30), habitait en face. Une autre de ces filles était mariée à un charpentier de Sens, THOMAS. La troisième fille, se maria à Paul BARON, qui fut boucher à Sens et Montigny-sur-Loing. La dernière, Yvonne, mariée à SAULNIER, s’installa comme marchand à bestiaux à Domats. Elle mourut jeune.
En 1900, la boulangerie était gérée par PONCET, un gars super nerveux. Je ne sais s’il buvait mais il lui arrivait certains jours, si la soupe ne lui plaisait pas de la passer par la fenêtre parfois avec l’assiette. Vers 1910-1911, j’ai connu un des ces mitrons, toujours vivant, Francis SANGLIER, qui habitait Roussemeau.
Plusieurs boulangers se succédèrent, entre autres, Aimé GREMY qui après la guerre de 14-18 remonta le fonds qui était liquidé. Il lui arriva pas mal d’avatars. Un jour faisant sa tournée sur Chaumot, son cheval mourut dans les brancards. Une autre fois, le feu prit dans le magasin en 1921, les pompiers combattirent le feu avec la pompe à bras pendant que le feu dévorait la couverture du fournil. On pouvait alors voir GREMY ayant une fournée à cuire, l’enfourner pendant que les pompiers sur le toit combattaient l’incendie. Tout se passa bien, le feu fut éteint et la fournée arriva à son terme. Il eut également pas mal d’histoires pour son alimentation en eau qu’il puisait en face dans le puit commun. Comme il était le principal utilisateur, il était le premier à en subir des gênes : rupture de corde ou autres. Fréquemment un chat moyé était remonté, alors à ce moment la plupart des usagers rouspétaient et ne venaient plus à l’eau, mais lui en avait besoin et c’était toujours des discussions. Je me rappelle toujours qu’après une remontée de chat, un groupe de voisins écoeurés s’enflammèrent contre tout et tous. Vint à passer l’adjoint RIGOLLET des Gaillards, qui subit les critiques de tous. Excédé, il eut un geste courageux, il fit tirer un seau d’eau, demanda un verre, le remplit et le dégusta. A la suite de quoi, il déclara : « L’eau est parfaite et ne sent rien ». A la suite de ce jugement, les habitants se dispersèrent rassurés. Le lendemain, GREMY remontait un chat crevé. Pour confirmation de cet incident, les incrédules peuvent se documenter auprès de Madame Louise GREMY à Cornant. C’était elle la boulangère à cette époque.
D’autres boulangers se succédèrent jusqu’à BAUBAN, aujourd’hui installé d’une façon luxueuse dans l’autre boulangerie. La boulangerie fit place en 1973 à une boucherie où se succédèrent deux bouchers. Le troisième est attendu dans une dizaine de jour. Il s’appelle GUINOT et est originaire de Villeneuve-la-Dondagre.
Cette propriété échoua à Paul BARON, et est aujourd’hui propriété de Jacky ROHR[20], son petit garçon.
57ème maison : remontons le chemin des cinq frères et dirigeons nous vers le nord. À gauche, il y a une propriété, rénovée vers 1900 par son propriétaire Maximilien MANSIOT, et louée au curé MEAUME. C’est là que nous allions au catéchisme. Il vivait avec son père et sa mère. Les leçons n’étaient pas dures quand c’était Monsieur MEAUME qui s’en occupait. Son père faisait la cuisine. Étant affligé d’un grand tremblement, nous avions remarqué que le vendredi, jour du poisson, celui-ci ne s’attachait jamais dans la poêle en raison de son continuel mouvement. Ingratitude de la jeunesse, nous voyions aussi son nez s’épancher dans la friture, c’était le goutte à goutte.
Apres le curé, divers occupants se succédèrent, puis le propriétaire l’habita. A la mort de celui-ci, ce furent ses nièces, Marie et Madeleine MOSSOT qui devinrent propriétaires. Elles l’habitèrent peu, la dernière venant de mourir il y a quatre mois[21]. Cette maison est instance de vente, et sous peu un nouveau propriétaire viendra s’y installer.
58ème maison : la propriété entre les deux siècles appartenait à un maréchal célibataire, Emile VERGER. Il y travailla seul jusqu’au jour ou son demi-frère Ernest COSSET s’installa plus loin.
La maison basse et forte ancienne ne représentait pas le luxe. A l’arrière en basse goutte, il y avait une vinée sans jour où logeait une mendiante, sans doute la dernière à Egriselles. On l’appelait GUITTONE, surnom qui venait du nom de ses frères des Régipeaux. Elle vivait de l’aumône des gens, glanant au cours de ses randonnées, un morceau de pain, un bout de lard, quelques pommes de terre, peut être deux sous. Ce fut le dernier spécimen des malheureux d’autrefois que je connus. Avait-elle soixante ou soixante dix ans, je ne sais pas. En tout cas elle n’avait aucune sécurité pour les lendemains qui ne pouvaient guère chanter.
Avoir au cours de sa vie, vu cela et la vie actuelle, pour moi c’est vieux. Je me vois très vieux et pourtant je ne me considère pas comme un croulant.
Aujourd’hui la maison rénovée, est la propriété de Monsieur Pierre CREVET et sa femme, maçon retraité qui jouit de sa retraite.
59ème maison : la suivante est la propriété de MICHEL Ange et fut construite en 1903. C’était une très jeune veuve qui hérita de son mari, bijoutier assez âgé, à condition de ne jamais se remarier. A l’époque, les conditions étaient valables mais au fur et à mesure que le temps passait, cela devint une condition draconienne. N’ayant jamais eu d’activité rentable, elle fut obligée de vendre sa maison en viager à une de ses sœurs ; plus jeune et plus nantie, pour mieux vivre. Alors survint un fait extraordinaire, sa jeune sœur mourut et elle devint son héritière. Elle hérita de tout ce qu’elle possédait et notamment de sa propre maison. De ce fait elle devint riche assez âgée. Elle fut conseiller municipal un peu pédante en la matière. Comme elle n’avait comme héritiers que de petits cousins, on eut penser qu’en souvenir de son passage aux affaires de la commune, elle fit une donation pour que se perpétue son bon souvenir. Hélas, le mécénat était pour elle une chose inconnue. Dans ce domaine, la commune ne fut jamais gâtée. Je veux citer le cas de Mademoiselle BOYER, institutrice à Egriselles pendant 35 ou 40 ans. Au cours de sa retraite après la guerre de 14-18, vers les années 1930, tomba dans la catégorie des employés de l’Etat à qui, après coup on versait un complément de traitement qui avoisinait les 600 000 francs de l’époque. Elle le refusa carrément, ne pensant pas qu’elle, disciple de Paul BERT et de l’école laïque, pu subventionner une œuvre des écoles d’Egriselles, son pays.
Que dirais-je de plus ? La maison fut construite par Célestin BENARD, maçon en vogue à l’époque. Aujourd’hui la propriété appartient à Monsieur et Madame LUQUET Gaston, anciens bouchers originaires de Puteaux.
60ème maison (CP n° 16) : maison légèrement plus récente, elle fut construite pour Monsieur et Madame BAZIN Louis (n°50). Ils en firent une petite exploitation agricole. Lui n’ayant jamais été qu’un ouvrier de bras acheta un cheval pour travailler. Cela lui occasionna pas mal de misère, car honnêtement il était plutôt gauche. Sa femme plus modeste, mais ingrate aux idées plutôt farfelues, se créa des situations plutôt cocasses dont la plus marquante fut celle du mariage de sa fille, Alice. Elle la fit rompre cinq jours avant la date, ce qui entraîna des péripéties que je ne puis relater ici. La fille se maria plus tard avec un second prétendant, POISSON, et eut un fils qui âgé aujourd’hui de 50 ans. Celui-ci est sorti de l’orbita familiale et est parfaitement sociable. Aujourd’hui, Alice retraitée des postes, chrétienne sectaire devenue veuve très jeune, se livre à des éclats incroyables. Pour une bonne compréhension du fait rapporté ci-après, je dois dire quelques mots de sa carrière de téléphoniste. Politiquement située, il lui arrive encore aujourd’hui, de joindre au téléphone un homme politique qui est opposé à ses idées. Ayant la communication, elle lui dit le mot de « Cambronne[22] » et raccroche soulagée. Elle habite aujourd’hui Sens, et d’après ses dires, sa dernière victime se nomme MARCHAIS.
La maison est vendue depuis quatre ans à des parisiens, Monsieur et Madame BOCQUET. Ils viennent toutes les semaines et y passent leurs jours de congés.
61ème maison (CP n° 13 et 16) : nous arrivons ici, à une construction importante : la gendarmerie œuvre de BENARD (n°33). Elle fut construite en 1894 pour le compte des époux COUDERC (n°19), rouenniers à Egriselles. Elle comprenait cinq logements, caves et greniers. Il devait y avoir un maréchal et quatre gendarmes. Ils arrivèrent fin avril 1895. Le lendemain matin ils étaient alertés pour enquêter sur un crime commis aux POLLIOTS, commune de Cornant, relaté au (n°34) où la femme survivante a fini ses jours.
Il passa beaucoup de titulaires en cette caserne. Je me rappelle les noms des premiers : CANUEL, GIBOISSEAU, POUSSARD puis, ROGER, MATHE, POULET, BREARD, QUESNEL, GISLON, GAY, qui fut maréchal des logis assez longtemps. Il était agréable. A force de surmenage, il étudiait toujours, vers les années 1906-1907, il fut enfermé à deux reprises pour troubles mentaux à Auxerre. A deux fois, il s’évada peu habillé et peu chaussé, et 24 ou 36 heures plus tard, il était à Egriselles près de sa famille, ayant fait le trajet à pied. Il n’était pas violent, les infirmiers venus par le train arrivaient après lui pour lui faire réintégrer l’hôpital. Apres eux années de traitement, il repris son service à la brigade.
Pendant son interrègne, ce fut POULET qui le remplaça, c’était un poulet qui sentait la vache ! Une anecdote sur CANUEL toujours à la recherche d’embêtements pour la population, intolérant. Un dimanche soir d’hiver, hors service, à la brume il se promenait dans la rue. Passant face à l’hôtel de la poste, il se présenta un homme sous le portail avec un ballot sous le bas. En un éclair l’homme en question reconnaissant le gendarme, dévala la cour puis le jardin malgré les injonctions de CANUEL. Finalement il s’arrêta pour que celui-ci constate que le ballot ne contenait que du linge sale. Le farceur en question était un ouvrier du propriétaire Zéphirin COSSET, qui portait son linge sale chez la blanchisseuse. Cela parait bien banal, mais il faut dire qu’en s’en fuyant dans la jardin, l’ouvrier passait sous les fils à linge tendus, mais CANUEL ramassait son képi à chaque passage. Il lui en tint rigueur longtemps car son nez en avait souffert aussi.
En revenant au maréchal des logis, GAY, je dois dire qu’il avait deux enfants, un garçon et une fille amie de ma sœur, qui devint institutrice dans le Jura. Elle revenait souvent à Egriselles. Quant à son frère (n°13), âgé d’un an de plus que moi, fit des études secondaires et au-delà puisqu’il finit sa carrière d’enseignant comme directeur de l’école des Arts et Métiers de Cluny. Il y a environ cinq ans (1972) il vint me revoir après un intervalle de 60 ans. Il resta peu car son désir de toujours apprendre le poussait à partir toujours plus loin. Je le regrettai vivement car pour moi c’était un enchantement de l’entendre expliquer le pourquoi et le comment de toutes ces choses. Il a un an de plus que moi, 83 ans, et je souhaite que continue sa passion d’apprendre toujours. Mon garçon le conduisit à Sens chez un condisciple, Georges BOUQUET, qui fut instituteur mais il le noya dans l’afflux de son savoir. Lucien me dit plus tard : « Je n’ai pas pu placer un mot », et il partit visiter les musées de la ville de Sens, pour encore enrichir ses connaissances.
Les gendarmes restèrent le temps d’un bail jusqu’en 1910. À cette poque la mère COUDERC y mit différents locataires, n’ayant pas voulu renouveler le bail des gendarmes. En 1920, elle décida de vendre la maison et ce fut mon père, Arthur DRION qui s’en porta acquéreur. Il vint y habiter en 1921 Lorsque je le remplaçai à la ferme. Il occupa le rez-de-chaussée et eut trois locataires au premier étage. Lorsque mes parents décédèrent, ce fut ma sœur Madeleine DRION qui devint propriétaire et habita au premier les trois pièces face sud. En 1954, je vins habiter ici avec ma femme, Jeanne CORNU, et cela dur depuis 24 ans. Ma vie ici fut partagée entre l’entretien du jardin et la descente à la ferme. J’y descends aujourd’hui pour voir ce qui se fait mais il fut un temps où ça allait beaucoup plus loin. Ma femme, de même descendait tous les soirs servir le lait aux habitants du pays. Elle le servit pendant 53 ans. Pour situer ma famille, je dois dire que j’ai 7 petits enfants de 15 à 29 ans. Six à Egriselles et une à Paris. A Egriselles, l’arrivée de ceux-ci se bouscula un peu car le troisième naquit quand le premier eut 21 mois et 15 jours. Si ce fut beaucoup de travail pour la mère, la grand-mère, (ma femme) n’en fut pas exempte. Aujourd’hui, se remémorant tous ces moments passés, elle leur pardonne de tout cœur les avatars survenus, de leur naissance à leur adolescence. Il faut voir une journée comme celle passée il y a trois jours, tous réunis pour Noël (1977). Suivant un mot à la mode, ce fut un séminaire, où tout le monde prêchait. Que de paroles, de mots parfois tronqués, tous pris sur un ton gai, aboutissant toujours à la grand-mère qu’ils aiment bien tous. Elle partage grandement leurs sentiments, et en est heureuse. Quant à moi, observateur attentif, c’est un plaisir sans mélange que j’éprouve. Ce fut pour ses enfants et petits enfants, une mère.
62ème maison : poursuivant notre périple, en face de la gendarmerie, se tient un atelier de mécanique que fit construire en 1922 Ernest COSSET, pour son garçon Raoul. Plus tard, vers 1972, il vendit à DOUMEIZEL, qui l’exploita peu. Vers 1975, il s’installa ailleurs et aujourd’hui c’est ROBERT Jacques qui l’occupe comme serrurier, accessoirement charpentier métallique, mécanicien et vendeur de gaz.
63ème maison : pour mémoire, en retournant sur nos pas, une maison Phénix, toute récente dont les propriétaires sont Monsieur et Madame VADROT, retraités venus de Paris[23].
64ème maison : descendant la rue, un maison aujourd’hui rénovée ou habitait avant 1900, le père BAREGE, maçon qui avait deux garçons. Le plus jeune, marié et établit maçon à Marsangy, fut tué au cours de la guerre de 14-18. L’aîné, Alfred, établi épicier rue du Pont à Villeneuve-sur-Yonne, était en même temps cordier. Ce fut son jeune fils qui continua le métier. Celui-ci est actuellement conseiller municipal à Villeneuve-sur-Yonne.
Par la suite la maison devint la propriété de PRIMAULT. Elle fut louée à Célestin LEMAITRE, maquignon et joueur de cartes impénitent. A l’age de 40 ans, le Docteur ESMENARD de Villeneuve-sur-Yonne, le condamna : maladie de cœur, de foie, de vessie. Au cours de ses tournées, il avait toujours sur lui un flacon de lait, qui lui servait de cordial. Né en 1852, il est mort en septembre 1945. Au mois de juin précédent, il était encore allé en bicyclette à Sens. Il eut sept filles qu’il qualifiait de sept garces. La dernière, veuve FOURGEUX, Lucie habite toujours Roussemeau. Célestin jusqu’à sa mort, est resté le garant d’un contrat qui engageait la commune. Au siècle dernier, il existait à Egriselles une fanfare (il en eut même deux qui s’opposaient), qui à la suite de désaccords ou de diminution d’effectifs, fut réduite à se saborder. Comme elle avait une caisse positive, il fut décidé qu’avec la somme, la commune achète un corbillard au seul service de celle-ci. Ce n’est qu’après la mort de Célestin dernier survivant de la société dissoute, que le corbillard pu faire le service des convois à Cornant. A cette époque, la fanfare « la société » avait son siège sous l’hôtel de la Poste et le propriétaire Alfred COSSET, en fut probablement le dernier directeur. Les gérants des deux hôtels, peut-être à la suite de cette liquidation, restèrent en possession d’instruments. Il y avait dans chacune des maisons un drapeau et une grosse caisse à la disposition des futurs conscrits. Ceux-ci à l’inscription à Noël, avec tambour et clairon, défilaient dans les rues et les hameaux du pays pendant deux jours. Cela se renouvelait au conseil de révision mais plus grand, avec le renfort des sous conscrits. C’était le défilé à Sens avec toute la clique de toutes les communes réunies qui était le plus impressionnant. Je me rappelle la dernière vécue, la classe 1915 où j’étais sous conscrits, je m’en rappelle le déroulement. Parti à sens par le train, rendez-vous à l’hôtel de vielle et à la sortie nous étions obligé de subir l’assaut des camelots, vendeurs de rubans, numéros, médailles. Les conscrits de Marsangy s’étant joint à nous, le soir, nous étions revenus à pied, manger à Chaume, chez GREMY. Nous avions veillé assez tard, et fatigués nous nous étions endormis dispersés. Le lendemain, la bouche pâteuse, nous nous rassemblions pour aller le midi, manger à Marsangy chez andré CHAMILLARD. L’après midi, défilé dans le pays puis rendez-vous chez un oncle de CHAMILLARD, ferme de Richebourg, plaine de Passy, où nous passions la rivière en bateau non sans quelques excentricités de certains. Rappelés à la prudence par le passeur, le père BLANCHET, nous arrivions à la ferme ou il y avait trois demoiselles, motif inavoué de notre visite. L’une d’elle, aujourd’hui Madame GIRAULT habite Marsangy, dont le fils st maire. Puis c’était le retour par le même chemin, toujours à pied, nous reprenions la route d’Egriselles et le soir nous mangions à Châtres chez DEVAUX. Nous faisions un crochet par les Riveaux pour rendre visite à une fille de la classe, Marguerite DUFOUR, future Madame BARRIERE René. Nous étions arrivé à Châtres en pleine nuit. Nous mettant à table, fourbus et aphones, l’ambiance durait jusqu’à épuisement des combattants ; nous nous endormions dans divers endroits non prévus à l’avance. Cette vie pouvait durer de deux à six jours, suivant le nombre des conscrits, car chaque famille recevait l’ensemble. Les sous conscrits étaient là en supporteurs, il leur incombait les taches accessoires comme porte drapeau, grosse caisse et clairon. Je dois signaler qu’à Marsangy, se joignait ce qu’on pouvait appelés les conscrits honoraires, DUPIN, COLBERT, et GREMY. Ils étaient de la classe chaque année. DUPIN était le père du garde-champêtre actuel de Marsangy. Si j’ai relaté tous ces faits, c’est pour que les générations actuelles en aient la photographie exacte.
Pour en finir avec ce numéro 64, je dois dire que Monsieur et Madame Octave PRIMAULT finirent leurs jours dans cette maison. Aujourd’hui vendue à un fonctionnaire colonial, Monsieur GIROUARD, elle a été modernisée par son propriétaire qui vient y passer ses vacances.
65ème maison : au XIXème siècle était une maison avec pignon sur la rue qui d’après mon instituteur fut habitée par une mère GRIOT qui éleva le général DUCHENE qui doit avoir sa rue à Sens. En tout cas moi, j’y connus la mère GIGUET qui eut deux filles. Son mari, GIGUET était le frère de la grand-mère de ma femme. La mère GIGUET avait une fille mariée à Ernest PICOUET cultivateur à Châtres. Ils eurent deux filles. Lucienne fut la première habitante du récent lotissement et la seconde fut mariée à LONGPRE, meunier à Roussemeau, propriétaire du moulin.
Par la suite l‘immeuble devint propriété PRIMAULT qui le démolit et fit reconstruire face à la rue. Il fut habité par Monsieur Octave PRIMAULT, aïeul de Pierre PRIMAULT et de Monsieur TORCOL, aïeul de Madame PRIMAULT. C’est le dernier PRIMAULT du nom, Jean-Paul, marié il y a quinze jours qui l’occupe aujourd’hui.
66ème maison (CP n° 12) : c’est ensuite la maison surmontée d’un étage où habite Pierre PRIMAULT[24]. Je n’ai pas de souvenir spéciaux à part que c’est la maison des jambes cassées[25].
67ème maison (CP n° 12) : nous arrivons dans la rue, une petite maison, propriété PRIMAULT. En 1900 elle était occupée par un charcutier, Amelins SARRAZIN, marié à Mathilde BUTTEAUX. Son père cultivait la ferme de Serbois. C’était un vieux paysan ne sachant pas lire mais qui savait compter. Je le revois encore avec un gros mouchoir roulé autour du cou. A cette époque, la moisson était faite par des taches qui finissant de couper, faisaient la grosse gerbe. C’était une botte spéciale à plusieurs liens qui rentrait à la ferme, le jour même montée sur une voiture. Chargée la botte debout était accompagnée d’un bouquet et suivant les situations, traversait le pays ou non, et rentrait à la ferme. Pour le fermier c’était l’occasion d’offrir à ses moissonneurs un repas bien arrosé, le jour même. J’ai dit plus haut que le père BUTTEAUX ne savait pas lire. Il lui arriva un jour, une histoire cocasse. Le lundi à Sens, était le rendez-vous des paysans qui s’y rendaient suivant leurs besoins par le chemin de fer avec retour le soir même. Leurs affaires faites, ces gens redescendaient à la gare. Suivant le temps disponible, ils allaient prendre un verre en attendant l’heure du train. Un jour se trouvant fort en avance, il entra au café et se commanda un verre, malgré sa répugnance à dépenser. Il vit certains clients demander un journal pour faire passer le temps, ce qui l’incita à en faire autant. Mais comme à cette époque, les journaux étaient vierges de toutes illustrations, il eut le malheur, lui se sachant pas lire, de le déployer les jambes en l’air e tourner les pages pour se documenter. Les clients présents connaissant son ignorance, eurent tôt fait de s’en amuser, ce qu’il ne comprit pas. Quand il prit sa retraite, il se retira à Villeneuve-la-Dondagre avec son fils célibataire. Celui-ci eut une fin malheureuse, partit à l’exode de 1940 avec un cheval et une voiture d’un voisin, ne donna jamais de nouvelles. La Loire et le pont de Gien lui furent sans doute fatals.
Revenons à la maison où SARRAZIN exploitait son fonds de charcuterie. Il y resta jusque vers 1910, époque où il alla s’installer à l’Hôtel du Commerce (n°26). Après son départ, SAVEL, chef cantonnier, occupa la maison avec sa femme couturière, puis, différents coiffeurs dont CAVIOTTE et actuellement LABARRE depuis vingt ans.
68ème (CP n° 12) : une maison ayant appartenu à Virginie BOURAT, une vieille fille bossue. Elle avait : un frère Isidore à Mongerin, un autre Ulysse à la Rue, un troisième Jules à Montigny, une sœur Clémentine mariée à ROUIF Jules à Ogny et une autre sœur, mariée à BAUMET charcutier à Sens, rue d’Alsace-Lorraine. Elle vendit cette maison à ces derniers, ne pouvant pas s’occuper de l’entretien. Les BAUMET eurent une fille, Renée mariée avant 1914 à un tapissier CHEURTIN. Il fut tué au cours de cette tourmente. Je crois qu’elle se maria deux fois par la suite. Elle vendit à un parisien, Monsieur LECOQ en viager, qui retraité l’habite aujourd’hui[26].
Pendant une trentaine d’années cette maison fut occupée par un tailleur, CALMIN, originaire du nord. Il finit la guerre de 1914 en cantonnement à Egriselles et décida de rester avec sa femme et ses deux garçons, Georges et Claude, et leur fille née à Egriselles. J’oubliais de parler de la période partant des années antérieures vers 1880. A cette époque, était installé un plombier zingueur du nom de POISSON. Il était surnommé « ça quin », déformation de « ça tiens » qu’il ne pouvait prononcer. Il avait un magasin où l’on trouvait toute la ferblanterie intensive de ménage, fourneaux, cuisinières … Pour l’époque, c’était bien achalandé. POISSON eut un fils, Marins, né en 1891. Lors de la guerre de 1914, il était soldat. Ayant une fiancée Juliette COCHARD de Collemiers, il se maria mais hélas il fut tué peu après ce qui condamna son père à la liquidation de son entreprise.
Ce serait tout sur la rétrospective de ce n°68 si je ne venais s’apprendre, ce jour 10 janvier 1978, la mort par suicide de Camille LEPINE. Il faut préciser que sa femme, Denise BOURAT, était la nièce de Virginie BOURAT, la propriétaire citée au début de cette analyse.
69ème maison (CP n° 12) : une maison dotée d’un premier étage qui était la propriété VIDOT. J’y connus VIDOT, un ancien gendarme à qui était attribué la régie. Figure peu aimable comme il se doit, sa femme avait une figure de porte de prison. La vente du tabac était moyennement financée, et donc octroyée à un commerçants du pays. La famille était sans doute assez à l’aise car elle possède dans le cimetière une chapelle en pierre de taille. La seule existante, où sont enterrés les membres de la famille, je sais que certains membres furent officiers. J’ai toujours vu la chapelle en l’état ou elle se trouve. Occupée en 1914 par des réfugiés, cette maison fut vers 1921 habitée par un peintre venant de Chablis, QUENARD. Il y monta une entreprise de peinture et devint par la suite lieutenant de pompiers. Il était un tempérament gai et fut toujours disponible pour réunions, fêtes ou concerts, il eut trois enfants qui tous quittèrent le pays. Il eut une fin tragique que l’on n’a jamais comprit. La maison qui était devenue propriété MAUROUX, resta inoccupée assez longtemps puis finalement viens d’être vendue voici deux ans. Le nouveau propriétaire doit s’appeler MONNEREAU.
70ème maison: une maison basse où était établi à la fin du XIX siècle, un charron, Victor DARDE. Il exerçait son métier pour élever sa famille : deux filles et un garçon. Sa femme Julie était toujours disponible pour aider les voisins même dans les cas les plus imprévus. Dans les jours d’été, le travail ne poussant pas, ils entreprenaient une moisson pour améliorer l’ordinaire. D’ailleurs le père BUTTEAUX (n°27) était un de ses employeurs attirés. Victor DARDE était à l’époque bedeau, et trois fois par jour, sonnait l’angélus. Il quitta cette maison dans les premières années de ce siècle lorsqu’un peintre, GOUSSERY, vint s’y installer. Il resta une quinzaine d’années puis alla habiter Gron dans une maison qu’il possédait.
A la suite Albert CROU retraité de la SNCF, devint propriétaire et l’habita. Celui-ci bon vivant adepte du canon de blanc[27], du mégot au coin des lèvres, avait une manière d’un mouvement de la tête et d’un clin d’œil de vous lancer une invitation dont il était bénéficiaire. Sa femme[28] ne voulant pas qu’il boive seul, sa cave était toujours de qualité. Il fut longtemps chef de gare à Mignière (Loiret) et il laissa parmi les voisins ou usagers un souvenir impérissable. Il devint veuf assez jeune (70 ans) et se remaria avec une handicapée physique presque invalide, soi disant lui, chrétien, pour faire une œuvre de charité. Il mourut vers les 90 ans et elle beaucoup, plus jeune occupe toujours une partie de la propriété dont elle a vendu le tout à DELIDAIS qui était peintre, en face. La maison est aujourd’hui habitée par Catherine GIRAULT, aide à l’école maternelle.
71ème maison : montons la petite rue appelée chemin de la messe, car aboutissant à un terrain propriété de Marius GUERIN où s’élevait le presbytère. A gauche, une vaste maison à un étage propriété de GOIS[29]. Je ne connus pas celui qui la fit construire mais sa femme assez âgée la mère Marguerite. Elle habitait là avec son garçon, Alphonse GOIS qui auparavant exploitait sa ferme à Châtres, ferme à gauche en allant à Chaumot. N’étant pas fait pour le travail de la terre et ayant des problèmes conjugaux, il se retira lorsque sa femme le quitta (non sans raisons je crois). Il loua sa ferme au père DAUMAT qui avait cinq enfants : deux garçons et trois filles. Alphonse GOIS avait une fille, Blanche qui se maria à un fils du fermier, Auguste DAUMAT. Après son mariage, il s’en alla être cocher de fiacre à Sens où ils eurent deux enfants Marguerite et Robert. Quand Alphonse GOIS fut mort, ses enfants vinrent habiter la maison, Auguste DAUMAT reprit le commerce et le portefeuille d’assurances[30] que gérait Alfred COSSET. Le temps passa, les enfants grandirent et vers 1946, Auguste devint maire d’Egriselles, poste qu’il occupa peu, il mourut à la mairie dans les bras du contrôleur des impôts. Après sa mort, Robert continua à gérer la maison jusqu’au jour ou celle-ci périclita par manque d’ordre et de saine gestion. Robert était un vrai brave garçon mais le ressort manquait. Son manque d’énergie éclata encore, lorsque vers la soixantaine, handicapé par un mal, il ne se fit pas soigner ce qui aboutit à l’ablation d’un pied. Il me dit un jour : « Si j’en suis arrivé là, c’est ma faute à moi seul ». Il traîna peu de temps et mourut dans la gène après avoir liquidé la ferme de Châtres et l’immeuble d’Egriselles. Sa sœur Marguerite, non avertie de la situation arriva pour recueillir le maximum de ce qui restait. La maison bourgeoise fut vendue à un technicien de la radio qui l’occupe aujourd’hui avec ses quatre enfants, c’est Monsieur REMEUF.
72ème maison : bordant la rue, une maison appartenant à Victor GREMY qui assurait le transport avant 1900, du courrier entre le bureau de poste et la gare deux fois par jour. Il faisait également le transport des colis et marchandises, ainsi le maçon BENARD qui achetait ses fournitures par wagon, lui fournissait un travail constant. Le deuxième courrier moins abondant, était les jours chargés assuré par sa femme. A cette époque trois facteurs se partageaient la distribution. Le premier faisait la moitié est du pays, Bracy, les Régipeaux, Chaume et toute la commune de Marsangy. Le second faisait la moitié ouest, le Pont Pourri, les Brouards, Châtres, Mongerin, les Riveaux, la Georgette et même la Voix Sourde, hameau aujourd’hui disparu. Il ne reste comme souvenir, chez moi une photo prise par mon fils Marcel. En revenant au pays, le facteur desservait les Gaillards et Montigny. Le troisième facteur desservait Ogny et toute la commune de Cornant. Alors que j’étais jeune cette tournée était assurée par le père MATIGNON, grand-père de Madame GARDEDIEU. Quand nous jouions sur la place à la récréation de midi, nous voyions déboucher du sentier de Cornant le père MATIGNON, qui rentrait au bureau sa distribution finie, pour reprendre le deuxième courrier et faire une deuxième distribution au bourg. Après quoi, il reprenait la route d’Ogny, pour aller se restaurer chez lui où habite toujours sa petite fille. Le soir à cinq heures il revenait pour une troisième distribution. Son seul moyen de locomotion fut ses jambes, il dû en user des paires de chaussures ! Pour en revenir à GREMY, celui-ci assurait le service des télégrammes, on disait à l’époque dépêches. La vie n’étant pas ce qu’elle est aujourd’hui, le messager était plutôt mal vu car souvent annonciateur de malheur. Une note gaie cependant, à une certaine époque le service des dépêches était assuré par Victor LATOUR, marchand de bicyclettes au garage BOUCHEROT. Celui-ci assurait le service pour une somme forfaitaire payée par la commune. Eternel râleur quand il fallait marcher, il fut un jour sonné pour un message à porter à la Gogette, en pestant il porta le message et q’enquit auprès des destinataires de l’importance de la dépêche. Ceux-ci plutôt gais lui donnèrent à lire et il vit inscrit « Bébé a une dent ». Inutile de décrire son comportement à son retour, ses voisins connaissaient le contenu avant qu’il ne parte.
Nous en étions sur Victor GREMY, celui-ci eut quatre garçons qui en firent voir de toutes les couleurs à leur mère Henriette car ils étaient plutôt dissipés. Le plus vieux fut fonctionnaire, le second Henri fut boucher à Véron, amputé d’un bras à la guerre de 1914. Le troisième, René, mon frère de commission classe 1913, fut incorporé aux chasseurs à cheval. Etant en patrouille sur la frontière, il fut avec ses camarades surpris par des Uhlans[31] qui les mitraillèrent, il reçut une balle à travers la bouche. Hospitaliser à Paris assez longtemps il se maria avec son infirmière. Le dernier Paul fut le farfelu de la famille. Il se maria avec la fille d’un serrurier de Villeneuve-sur-Yonne, nommé DECHAMBRE. Il fit un peu de tout mais peu à la fois. Le père Victor GREMY se tua dans la cote de Bracy, lieu dit des Charmes, en allant voir son fils Paul en 1941 (chute de bicyclette).
A l’arrière remontant vers le nord, existait plusieurs pièces dont une occupée par la mère de Victor GREMY. Lorsque Victor GOIS cessa de travailler vers 1912, la maison fut vendue à Paulin HUSSENET qui quittait sa ferme à Ogny. Il fit remettre à neuf l’ensemble qui en avait bien besoin. Il fut maire quelques années et lorsqu’il mourut, la maison fut achetée par Marins GUERIN électricien qui y loge quelques un de ses ouvriers.
73ème maison : maison de Cécile RENVOISE, qui donna son nom au lieu dit la mare à Cécile après Serbois. Cette mare lui appartenant car située dans une pièce de terre de deux hectares à elle. Je me rappelle très bien d’elle, d’une famille assez aisée, à l’époque ses terres lui rapporteraient peu et elle vivait chichement. Agée, la figure d’un jaune verdâtre, elle avait autant de rides que la bourse peut être aussi vielle qu’elle d’où elle extrayait les deux sous pour payer son fromage blanc. Elle venait chercher chaque semaine chez mes parents avec une assiette dont le fromage percé servait de passoire pour le petit lait. Elle avait une vigne dans le coin mord du lotissement actuel. Cette vigne en friche envahit de cerisiers (griotte) elle faisait la boisson de cerises pour son usage personnel, je ne crois pas que cela pu l’étourdir. Lorsqu’elle fut morte, la maison fut achetée par Victor DARDE, charron (n°70). Celui-ci fit construire un atelier où il exerça sa profession de charron, sa femme Julie était toujours disponible comme laveuse de lessive, femme de ménage, même infirmière. Sa vie était rendre service. Ils eurent trois enfants, la plus vieille des filles était de santé délicate, mariée à BACHELET (boucher) leur laissa deux petits enfants à élever. La deuxième fille Fernande, mariée à un ouvrier boulanger, BROUETTE, quitta le pays. Le garçon Léon, conscrit de son voisin POISSON, revint de la guerre avec une jambe de moins ; il fut parmi les premiers à obtenir un emploi prioritaire, il entra dans une compagnie d’assurances où il arriva à un poste assez important. Il avait été marié, jeune à une fille d’Ogny, Elise DIONNE. Le ménage dura peu, il se remaria une fois ou deux et ne revint plus au pays.
Victor DARDE fut fossoyeur et bedeau, à cette époque le dimanche il assurait les sonneries et pendant la messe effectuait la découpe du pain béni qu’il distribuait ensuite. Un simple dimanche ce n’était guère que du pain, les jours fériés c’était de la brioche. Avant de faire la découpe, tout en se promenant, il faisait le compte des assistants et morcelait en conséquence. C’était un petit tempérament mais il avait un faible pour les crêpes. Venu un soir chez mes parents alors que ceux-ci étaient en pleine fabrication, il refuse l’invitation pour la simple bonne raison que s’il y goûtait c’était la douzaine ou rien du tout. Quand la maison fut vendue, ce fut le maréchal d’à coté qui l’acheta, Nestor SANGLIER. Il la loua à Raymond MANSIOT, puis la vendit à Antoine, un portugais dont deux filles sont mariées au pays, CHATON ET JACQUES Claude. Antonio revendit ensuite à André JACQUES et celui-ci en a fait son domicile.
74ème maison (CP n° 7 et11) : au siècle dernier, le propriétaire Eugène HUOT qui fut maire de la commune, grand, maigre, figure anguleuse coiffé d’un chapeau noir et plat à grands bords, un galon noir autour du cou, une blouse à mi corps et sa canne, figure plutôt rêche c’est ainsi que je le connus. Par moquerie, ses contemporains l’avaient baptisé queue de cesse (en français cesse égal écope) c’était un adepte de Combes et de son sectarisme. Il vendit sa maison à Ernest COSSET déjà installé maréchal au fond de la cour. Vers les années 1911-12, il fut raser l’ensemble et reconstruire en l’état actuel. Ce fut un maçon de Vernoy, Anatole DESMEUZES qui la construisit. Pour mémoire ce maçon partit pendant la guerre de 1914 en renfort à l’armée d’Orient. Ces troupes embarquées à bord du Massilia, un paquebot fut coulé par un sous-marin et coula corps et biens. En 1913, COSSET ouvrit une auberge et ce fut bientôt la guerre, le commerce ne partit pas vite et lui-même COSSET, me dit plus tard que s’il n’était pas venu à la fin de la guerre de troupes, au pays il aurait été contraint de vendre ses terres pour se remettre à flot. Par la suite il abandonna le commerce et se logea dans une partie de l’immeuble. La grande salle et plusieurs chambres étant louées à LEAUTY « Nouveautés habillements », celui-ci vendit à THOMASSIN qui mourut jeune. Son fils lui succéda et en 1973 alla s’installer dans une maison qu’il venait d’acheter. Aujourd’hui, c’est son fils Raoul qui est propriétaire et la partie qui était commerçante est louée à ces parisiens. Quand COSSET maria sa fille Simone à SANGLIER maréchal. Il exerça dans l’atelier du fonds de la cour se logeant à coté. Après la guerre 1939-45, il vendit son fond à JACQUES, son collègue. Ce bâtiment du contre est dans la propriété et le domicile de Nestor SANGLIER, sa femme Rachel étant décédée, il y a plus de vingt ans.
75ème maison (CP n° 11) : la maison d’école construite à la fin du XIX siècle. Il y eut comme instituteur Monsieur COQUIN puis vers 1900, Monsieur et Madame GAUTHEROT, qui avaient trois garçons : René 1886, Charles 1888 et Marcel 1895. L’aîné René, après une grave blessure dans l’aine en 1914, était au début de 1915 affecté comme instituteur mitrailleur pour stage d’officiers à Bourges. Nous nous sommes retrouvés à quatre autour d’une bonne table : lui, moi, René LETOFFE et Albert GUERIN sur son invitation. C’est la seule rencontre que je fis durant la guerre avec des camarades du pays. Il ne du pas retourner au front et je su par la suite qu’il était professeur à Marseille. Charles le second qui avait embrassé la carrière des Postes, mourut à 17 ans, tuberculeux victime d’une imprudence. Alité de longs mois, son infirmière, la mère HERY, lorsqu’il étouffait, descendait chercher son père, pendant son absence avec l’inconscience de l’age. Tous unis nous faisions la pantomime, cela finissait quand il rouvrait la porte et nous le voyions pleurer, cela me rend triste aujourd’hui. Le troisième Marcel, parti comme moi en 1914, fit sa carrière au Paris-Lyon-Marseille comme dessinateur, seule discipline où il excellait, il n’eut jamais la curiosité de revenir au pays. J’étais entré à l’école le 4 mars 1900 avec Madame GAUTHEROT et si j’avais l’esprit assez vif, je n’avais pas les mains agiles, mes cahiers barbouillés mettaient ma maîtresse en colère. Je fus plus heureux lorsque je passai vers mon mari. A cette époque, fut crée la cantine pour les mois d’hiver. La première cuisinière fut la mère de Victor GREMY que l’on vient de voir. C’était une femme très compétente et lorsqu’elle quitta son poste sa remplaçante fut beaucoup moins appréciée. C’était une femme d’Ogny que l’on appelait Angéline.
Encastré dans le mur de la tour, se trouvait un baromètre, don d’un député de l’arrondissement de Sens à toutes les communes. Ce devait être JAVAL, père dont le fils Jean JAVAL fut député par la suite. Au dessus était une cloche munie d’une chaîne qui servait à sonner le début du marché. Pendant et après la guerre, se succéda au poste d’instituteur, différents maîtres dont le ménage GUILLOT qui resta plus de vingt ans. Après suppression de postes, c’est aujourd’hui une école maternelle d’une trentaine d’unités, dirigée par Madame LARCIER, aidée par une femme de service, Catherine GIRAUD.
76ème maison (CP n° 8) : l’église est probablement le plus vieux bâtiment du pays, je ne saurais fixer sa date de construction quinzième ou seizième siècle. Elle fut occupée par les allemands en 1870, le clocher servait de poste de guet et lorsque les francs-tireurs vinrent les attaquer de nuit, ils firent de nombreuses victimes. Cette troupe était composée de volontaires venant de l’Ardèche (la Voulte) et d’hommes de la région. Le chœur de l’église étant en mauvais état, peut être à la suite de la chute mortelle du père GUINOT, maréchal et bedeau qui se tua lors d’une chute. Vers les années 1903, les voûtes furent refaites, travail qui s’avéra aujourd’hui trop coûteux. Le reste de l’église fut rénové vers 1922. Le pignon est menaçant ruines, il fut supprimé en 1968 une travée[32], et les grandes portes firent implantés à l’est, voici une dizaine d’années. Cela donna une impression de modernisme en même temps que de grande aisance à la route. Entre les piliers du clocher fut élevé un monument à la mémoire des morts de la guerre 1870-1871. Enfin sous la municipalité BARON Arsène maire et GUERIN Marcel adjoint, le clocher fut pourvu d’une horloge. Grâce au désintéressement de ces deux enfants du pays, ils refusèrent d’empocher les indemnités qui leur étaient allouées pour le service de la commune, du fond de mon cœur qu’ils en soient remerciés.
Le mercredi sur la place de l’église se tenait le marché, produits de la ferme, fournitures pour le ménage etc.… Longtemps les marchands de volailles, marchands ambulants, commerçants de toute sorte y fréquentèrent les volailles ROUSSEAU et PREAU COULON, RAMBERT de Villeneuve-sur-Yonne, PASTUT de Sens avec son éternel melon et ses chevaux impossibles. Lorsqu’ils étaient attelés, il fallait monter dans la voiture à la volée. Voulant faire revivre l’ambiance des marchés d’autrefois, je vous en décris la teneur.
Marché du 11 juin 1890 Primes[33]
Colin Louis Ogny 11kg
Veuve Quatre la Closerie 5kg250 1 beurre
Bazin Louis le Bourg 7kg250 1.50
Pertuisant 9kg
Mitais Alzir les Brouards 11kg500 2
Grelot Alexandre 11kg 1.50 prix supplémentaire
Il n’y avait que deux prix par marché, aussi les jours très bien pourvus, étaient distribués des prix supplémentaires. Le premier prix de ce 11 juin 1890, Alzir MITAIS a sa bru toujours vivante, c’est Madame veuve Emile MITAIS aux Belles Maisons.
Marché du 9 juillet 1890 Primes
Colin Louis 5kg
Mitais Alzir 9kg 2 premier prix beurre
Polliot Alexandre 7kg
Gremy Théophile 7kg500 1 deuxième prix
Benard Alderic Mongerin 7 de canards 2 volailles
Marché du 10 septembre 1890 Primes
Leveque Louis 6 pièces de poulets 2
Foire du 8 octobre 1890 Primes
Leclerc Louis 9 paires de poulet 2
Gois Alexandre 10kg beurre 2
Mansiot Emile 9kg de beurre 1
Il peut paraître drôle qu’il eut deux prix de 2. Il y en avait un en volailles et un en beurre.
Il y avait une fois par mois, un auvergnat de Courtenay marchand de couteaux, ciseaux, repasseur de surcroît, qui était là. Il s’appelait VALARCHER. Malgré qu’il eut eux charcutiers au pays, il en venait un troisième de Courtenay, qui vendait tout le long du parcours et finissait sa tournée au marché d’Egriselles. Il s’appelait REGNAUD, son chien me faisait peur, il était plus grand que moi. Il y avait également un marchand marée et châtaignes, le couple LEFEVRE ou GIBIER venait de Domats.
A la récréation de 14 heures, il y avait autorisation par notre maître, pour tous, d’aller sur le marché profiter des châtaignes que les parents nous offraient. Le soir, au retour à Domats, GIBIER était effondré au fond de la tapissière couverte et le cocher le remplaçant, tenait son poste jusqu’au bout. Ils eurent une fille, veuve de guerre qui longtemps vendit des châtaignes à Sens et des sucreries dans les fêtes ou ventes. Pour ceux de cette époque on appelait la mère, Marie barbouillée, et la fille du même nom. Elle était remariée à LETENDRE de Gron. Un maraîcher venant de Sens, GUEGE, passant par Gron, Collemiers et Cornant, finissait sa tournée également à Egriselles. Il s’installait sur le trottoir aujourd’hui à THOMASSIN. On pouvait voir sur le trottoir de l’époque, deux voitures de marchands de cochons, dételer pour le repas les chevaux pris dans les écuries des deux hôtels. Ces hôtels avaient un homme qui s’occupait spécialement de l’écurie les jours de foires ou marché, il n’y avait jamais moins de six ou sept chevaux. Les commerçants en cochons avaient une manière spéciale d’atteler, il ne fallait pas que les limons pèsent sur le dos du cheval mais que ce soit un continuel balancement entre le haut et le bas. Ces marchands étaient CLEMENT à Courtenay, maison toujours présente, mais livre aujourd’hui en viande morte et THEVENON à la rue Chèvre (Subligny) dont l’arrière petit fils n’est plus qu’exploitant agricole. J’ai vu certains jours de marché des marchands de chansons qui ne furent même en ville survivre à la radio. J’ai la survenance vers 1902 lors de la catastrophe de Courrières[34] de la venue d’une équipe et j’ai encore en mémoire les premiers vers que voici : « Dans la mine et sous les décombres. Où sont morts plus de 1.200 mineurs ». Plus tard ce fut le chant pour le 17ème de Béziers. « Salut, salut à vous, braves pioupions[35] du 17ème, cela me sonne encore aux oreilles comme si c’était hier ». Le marché fini sur la place, les portes même mieux garnies c’était la visite aux camelots et aux commerçants sédentaires. Tous les mercredis étaient présents les vétérinaires de Sens et de Courtenay qui s’arrangeaient de visiter leur clientèle campagnarde en faisant une pause au marché d’Egriselles. Les cafés étaient pleins et cela se poursuivait jusqu’au soir car le commerce fini, les boutiquiers allaient prendre un verre ou jouer aux cartes. Pour certains habitants de la campagne, le mardi était leur dimanche, je citerai par exemple le hameau des Régipeaux où les joueurs de cartes poussaient parfois loin l’heure du retour. Il y avait le père Louis CHARDON, petit bonhomme qui, lui venait faire sa partie de billard mais ne s’attardait pas trop par contre les DUVAL, frères ou cousins, étaient tenaces et malgré la distance revenait parfois le dimanche, à pied, bien entendu. Je pourrais poursuivre cet exposé, je préfère passer derrière l’église sur le champ de foire ou selon mon grand-père se tenait tous les ans, une foire importante le 18 mai. C’était principalement une foire à moutons qui d’après mon grand-père pouvait atteindre le millier de têtes. Un menuisier, le vieux père TELLIER avait la charge d’installer des parcs avec des chaînes qui la foire finie, étaient rangées pour la suivante. Les vendeurs venaient parfois de loin mais n’étaient pas embarrassés pour nourrir leurs bêtes au grand désespoir des fermiers exploitants au bord des routes. C’était certainement un grand mouvement de personnes, mon grand-père à l’age de 18-20 ans, c'est-à-dire vers 1860, aidé de son frère, se transformaient en garçons d’écurie pour la foire et pouvaient avoir 15 ou 20 chevaux à s’occuper à 1 pièces. C’était pour eux un coup de bourse à l’époque ou un journalier gagnait 1 ou 1.50 par jour. Il y avait d’autres foires au cours de l’année, celle-ci était la plus renommée. Dans ma jeunesse, je me souviens avoir vu dix ou douze bovins amenés par des maquignons de Courtenay. Ma mère m’a dit que lors de sa jeunesse vers 1875-1880, il arrivait que la rue principale du pays sur 400 mètres mais était garnie des deux cotés de camelots. J’y vis moi-même un jour un manège de chevaux de bois. Je ne vis jamais de rotonde mais il y avait bal en salle en matinée. La dernière fut probablement en 1911 où ma cavalière du jour, de deux ans mon aîné, était ma voisine LETOFFE de la ferme de la Foret. Elle vit toujours et est propriétaire de la maison qui fait face à la place. Ce jour du 18 Mai, vit aussi une exposition de machines agricoles, lorsque le maréchal se fit représentant de la marque Osborne, machines de récoltes et de travail du sol. Le début si j’ai bonne mémoire devait être en 1904 et l’exposant COSSET Ernest, maréchal.
J’ai bien d’autres souvenus sur cette place mais je dois relater le plus marquant. Les élèves de l’école avaient pour aire de jeux cette place, c’était le jeu de balle à cheval ou autre, c’était les basses les jours froids, c’était le palet comme enjeu des boutons de culotte, ceux-ci, les derniers en cas de déveine. Il arrivait que ce fut l’époque de la fronde (jeu ou arme). Un jour alors que c’était la vogue, tous armés e cet engin, nous faisions s’envoler des marrons ou des cailloux. Un de nous envoya un caillou dans une fenêtre de la maison d’en face, ce fut un silence de mort. Le carreau ne tomba pas, cela paraissait bénin mais, derrière le trou fait par le projectile, se tenait une couturière à longueur de jour, par une chance inouïe, elle venait de se lever. C’était la mère DRIAT qui sortit folle de colère et s’en vint trouver notre instituteur, il y avait matière à discussions. La coupable, c’était nous tous, d’autant plus que son garçon et le fils de la plaignante était parmi les accusés. Notre instituteur en fut quitte pour payer la casse. Une porte d’armoire qui servit de cible témoigna de la force de pénétration du projectile. L’histoire s’arrêta là, heureusement, la mère DRIAT, pouvant être tuée, à la rentrée des classes, confisqua les armes avec incinération immédiate. C’était la meilleure fin pour tous.
Pour le 14 juillet, selon le rite habituel, se déroulait les jeux traditionnels, pour tous les ages. Je me rappelle que pour les enfants ne dépassant pas huit ans, il y avait distribution de gaufres anglaises Palmer Humtley. On en recevait chacun deux, tirées d’une boite métallique. c’était pour nous à cet époque du jamais vu. Ce jour du 14 juillet, était tiré par les pompiers le feu d’artifice, avec fusées de couleur variée, soleil, feux de Bengale, etc. le canon qui tonnait fort était toujours confié à deux sapeurs sérieux, car c’était assez dangereux. C’était toujours VAUDOUX et PEPIN. Les jours de fêtes patronales Pentecôte et fin septembre, amenaient un afflux de population et étaient les plus renommées de la région, quel contraste avec maintenant. Une troisième fête avait vu le jour après la création de la cantine scolaire, et lorsque celle-ci cessait de fonctionner, après les mois d’hiver, une fête en marquait le terme. La première sous rotonde eut lieu place de l’église, coté commerçant, c’était des chants d’enfants, individuels ou groupe, saynètes etc. Par la suite l’emplacement de la fête foraine, ce qui contribua à la rendre égale aux deux autres. Je me rappelle surtout d’une de ces fêtes où était venu un marchand de nougats. Fortement approvisionné, il était muni d’un appareil où l’on misait deux sous. Pour les gagnants il y avait deux tablettes de nougats, et pour les perdants une seule. Il fut submergé jusqu’à épuisement du stock.
Adossé à l’église, était à l’époque le bûcher de l’école, le bois entreposé était scié à cette époque par une espèce d’ermite vivant dans une cabane (CP n° 17) qu’il s’était fait dans la marnière des Hullins, il vivait frugalement. Madame l’institutrice lui faisait une gamelle de soupe chaude pour son midi, ce qu’il appréciait. Dans sa hutte il avait une douzaine de pendules comtoises, vêtus de guenille et couchant sur un grabat. Les dimanche de beau temps, son campement était un but de promenade. Son site fut photographié et vendu en carte postale. On devrait aujourd’hui retrouver dans de vieux tiroir cette photo. C’était le père GRENOUILLE, c’était tout ce que l’on savait, il disait venir de Paris où fut détruits pendant la Commune, la trace de son origine. On ne sus jamais son age.
77ème maison : reprenons en face le champs de foire, une maison propriété LECLERC, où Auguste CROSSIER exploitait quelques terres à la fin du XIXème siècle. Vers 1904, il s’en alla exploiter à Lailly. Mes grands parents m’ont dit que les occupants antérieurs vendaient les jours de foire ou de fêtes des rafraîchissements, du vin sans doute. Il existait dans la cour, un fournil occupé par la mère BREZILLON. C’était une vieille femme maigre à la figure de sorcière, qui du subir les sarcasmes des gosses environnants, G. DUPIN et les frères GREMY étant les principaux. Apres la guerre de 1914, la propriété fut vendue à Albert LETOFFE, qui quitta la ferme de la Foret. Il la fut démolir et édifié le nouvel immeuble. Lorsqu’il fut mort, la propriété revint à sa fille qui aujourd’hui âgée de 85 ans, en est toujours propriétaire. Celle-ci, Léa LETOFFE, épouse FOUTRIER invalide de guerre, eut un fils qui mourut voici deux ans d’un cancer. Il reste une petite fille.
78ème maison : à cote la maison où en 1900 logeait DRIAT, chef cantonnier ainsi que ses deux enfants et sa femme (n°76). DRIAT, d’une conduite peu conforme avec la vie d’un chef, d’une grande intempérance, fut mis à pieds et nommé ailleurs. A la suite la maison fut occupée par un facteur, un célibataire, AMBLARD. Il avait pour compagnon un chien qu’il appelait Postillon. C’était un affreux barbet couleur chocolat. Pendant la guerre 1914, la maison fut occupée par des réfugiés belges de la famille PIERRON. La maison devint la propriété de Souveraine LECLERC, venant de Montigny avec sa fille Berthe[36]. Célibataire, celle-ci travaillait quelques heures par ci, par là, ne connaissant pas la pendule. Ensuite la maison fut vendue et aujourd’hui ce sont des parisiens qui viennent y passer leurs congés.
79ème maison : lorsque Camille MAROIS cessa d’exploiter les terres de la Foret, les frères ROULIN y firent construire la ferme actuelle. C’était en 1904. Elle fut construire par BENARD, l’entrepreneur en vogue. Le premier fermier fut LETOFFE, dont on vient de parler. Il y resta quinze ans et fut remplacé en 1921 par BALLAGUET qui eut quatre enfants. Il avait du apprendre la fable du laboureur à ses enfants. Il ne laissa guère à la terre le temps de se reposer. Elle était sa vie et il ne la ménagea pas, il avait la force et la ténacité. En 1938, il se retira et fut remplacé par BERGERE venant de Venizy et aujourd’hui c’est le fils BERGERE qui en est propriétaire et qui l’exploite.
80ème maison (CP n° 1) : je reviens à la rue centrale face à la face est de l’église, une maison d’angle avec un étage. Au rez-de-chaussée, fin XIXème, une épicerie tenue par Constant MAROIS, gendre POLLIOT. La maison faisait aussi la graineterie et bureau de tabac. A cette époque, on achetait peu à la fois. Par exemple, le sucre en cône de 40 centimètres de haut était attaqué par un coutre, frappé par un marteau, le sucre en morceau était inconnu. Pour le café, le demi quart[37] était grillé par le vendeur. Les jours de torréfaction il faisait bon à respirer alentour. Cela dura jusque vers les années 1930. Le tabac était vendu aussi en détail. Sur le comptoir les pots à tabac en faïence blanche et filer bleu, contenaient les différentes présentations. Sur le comptoir une balance à bras avec plateaux en corne, servait à peser les quatre ou cinq sous de tabac à fumer. A l’époque le paquet[38] valait dix sous. Quand c’était du tabac à priser, deux sous à la fois, il ne fallait pas que le tabac entraîne le poids. Cependant quelques gros fumeurs des hameaux tel le père Théophile GREMY aux Brouards, pouvait le mercredi emporter dix paquets de gris. Il devenait la providence des fumeurs du coin, dépourvus. Comme la maison faisait les graines, Constant MAROIS, partait en campagne canne à la main, pour prendre les commandes des clients. C’était pour le printemps, avoine, orge, vesce, betteraves etc. il était familier, ne crachant sur rien, il lui arrivait de rentrer assez ému, sa femme Mélina, le couvrait et l’envoyait coucher. Il était alors indisponible. A cette époque, un compagnon maçon du nom de LECLAN travaillant à ses heures et buvant à d’autres, avait mis en parallèles leurs malaises réciproques par cette formule : « Monsieur MAROIS indisposé, LECLAN saoul comme un cochon ».
Ce fut Eugène DUPIN, menuisier (n°36), qui lui succéda en 1903 et géra la maison jusqu’en 1922. Après se succédèrent, DUPONT, BOURGEOIS, DADOU, VOLFF, DUMOTIER, PIDET, COLOMBERO. Ce dernier mourut en place, sa femme continua seule plusieurs années. Elle avait une tenue de boutique qui faisait l’émerveillement de tous. Lorsqu’elle quitta, il n’y eut pas de successeur. C’est alors que s’installa un électricien qui ouvrit un magasin, la maison MICHEL.
Au dessus, fin du XIXème, Alfred GOIS le propriétaire, apiculteur assez important, fut maire de la commune pendant près de trente ans. Sous son règne fut construite la petite route des Régipeaux et celle de la Tuilerie en 1904, je crois. Elles furent bénéfiques aux hameaux. Par contre il en fut autrement lorsque son petit fils, le maire actuel, eut l’age de fréquenter le lycée de Sens. il devait matin et soir prendre le train. En hiver, comme il faisait noir et pour qu’il ne soit pas seul, le grand père avait trouvé le moyen de faire établir par la poste un courrier supplémentaire afin que les facteurs le portent au dit train. De cette manière était résolu le problème du retour pour l’enfant chéri. Je ne sais si ce courrier supplémentaire apporta un grand bien être à la population, en tout cas les facteurs, courriers à tour de rôles ne le faisaient pas faute de critiques acerbes. Le dernier, DIOT a été enterré hier, 27 janvier 1978. Il avait 96 ans, il n’avait jamais digéré l’histoire. De ces différentes actions ou abus de pouvoir, il existait un état latent de mauvaise humeur. Aussi quand le docteur SERFATY présenta une liste d’opposition, la situation fut retournée. C’était la fin d’un règne, c’était peut-être normal.
Dans le même immeuble, en suivant, était établi un tailleur, Victor SANGLIER. Grand et sec comme un échalas[39] avec toute sa barbe en bataille, il était plutôt vilain. Sa fille se maria à un ouvrier boulanger, PESLIER, qu’il installa boulanger à Montacher. Lui-même lorsqu’il cessa de travailler, alla habiter là-bas où il fut maire de la commune assez longtemps. Entre temps, il avait vendu son fonds au couple JACQUONIN, venant de Domats. La guerre de 1914 contribua à la disparition du fonds.
81ème maison : maison du père COMAILLE Eustache, qui fut toute sa vie journalier[40] agrémenté d’une femme dont la qualité principale était de geindre. Ils eurent deux enfants, Achille qui fut boulanger à Paris et Emile, représentant à Paris également. Etant journalier et ne savant pas écrire, il tenait quand même à jour son emploi du temps. Il avait plusieurs employeurs. Voici sa méthode. Il achetait un calendrier éphémérides et les jours consacrés à un patron étaient soigneusement mis de coté ; lorsqu’il s’agissait d’une demi journée, le numéro était déchiré à moitié. Lors des règlements de compte, il venait avec sa pile de journées (son livre de compte). Certains jours je lui tenais compagnie dans son travail. On parlait un peu de tout. Un jour parlant histoire, nous arrivons à parler de la Révolution de 1830 (n°12). Pendant la guerre de 1914, la maison devint la boulangerie car celle-ci était en cours de reconstruction. A la fin de 1914 avant de partir soldat, le 19 décembre, j’étais mitron dans la maison.
La maison fut vendue à Ernest GOIS, propriétaire voisin, qui en fit sa demeure. Après des études supérieures en médecine, ratées pour cause d’intempérance, revint se marier et devint apiculteur et vigneron, succédant à son père mais pas avec le même bonheur. Les jeunes et moins jeunes de l’époque profitaient souvent de ses gestes généreux lorsqu’il sacrifiait à Bacchus une seule condition, l’appeler Monsieur. Lorsqu’on le voyait penché dans l’ouverture de sa porte coupée, c’était signe qu’il y avait de l’électricité dans l’air. Son fils grandissant, lui succéda dans ses activités mais ce ne fut jamais la gestion du grand-père qui à son apogée avait jusqu’à huit cents paniers ou ruches. Le fils GOIS, maire de la commune pendant trente ans, est sans doute plus doué pour ce genre d’activités. Elles sont plus conformes à ses aptitudes faites d’imagination et de flatteries envers la multitude. Etant ni malléable, ni flagorneur et absolument pas orgueilleux, mais habité par une fierté farouche, je ne prendrai pas part à l’analyse de son comportement. Cependant je dois relater une anecdote. En visite à Paris, je me trouve un jour mêlé à une réunion légèrement familial au titre d’auditeur. Un couple était face à face. Le mari essayait de faire avaler des couleuvres à sa femme par des arguments qu’il voulait persuasifs et répétés. La femme nullement convaincue, lui posant la main sur le bras avec douceur, lui dit : « Chéri arrête, tu goisises ». Ce mot me frappa et depuis il est toujours présent à mon esprit. Ces personnes au cours de leurs séjours répétés à Egriselles, avaient beaucoup observé. « Tu goisises », quelle conclusion merveilleuse !
82ème maison : maison à l’origine propriété de Monsieur ROBINET. Sa femme née, ROULIN, quincailliers à Paris. Le ménage ROUIF l’habitait. Alphonse surnommé « Gambaud », manouvrier toujours en tache, était aussi bûcheron, botteleur, terrassier, bineurs de betteraves. Je le vois encore portant sa montre en sautoir, il était dur au travail mais tenace aux cartes et à la boisson ce qui faisait le désespoir de sa femme. Il avait aux Riveaux, un demi-frère JAMBON dit la Gobette, ancêtre de la famille DIOT. De goûts identiques, ils se retrouvaient assez souvent au café. La durée de leurs retrouvailles variait en fonction du gonflement du porte-monnaie. Cela pouvait durer d’une soirée à plusieurs jours, et jouant la boisson, ils ne se faisaient pas de cadeaux. Il arriva qu’un jour, fastueux sans doute, ils jouèrent une bouteille de champagne. A cette époque cela coûtait 5 francs. Le gagnant but la bouteille et le partenaire de frère qui avait soif commanda une cannette de bière. Par époque de pleine lune, en juin, alors qu’il bottelait dans les champs, GAMBAUD travaillait toute la nuit. Je l’ai vu comme bûcheron, faisant des fagots d’acacia, empoigner la marchandise comme si c’était du bouleau, les épines lui importaient peu. Sa femme journalière en lessive, était d’une grande propreté. Je la revois en bonnet blanc impeccable quand elle lavait chez mes parents. Le midi quand je revenais de l’école, c’était toujours le même rituel. Je prenais place dans le garde genoux à coté d’elle et je lavais un mouchoir, après quoi nous allions à table. Elle se nourrissait elle-même ne recevant jamais rien de son mari. Ils eurent deux enfants et il reste aujourd’hui une petite fille à Saint Valérien, Lucienne BENARD veuve BROSSARD. Quand la maison fut vendue, ce fut Laure ROBINARD, une voisine qui l’acheta. Elle passa en beaucoup de mains locataires ou propriétaires. Le dernier depuis ces dernières années est Madame PERRET, une parisienne veuve de la dernière guerre.
83ème maison (CP n° 19): une vieille maison propriété du père CEVIN. Ce qu’il faisait, je ne le sais pas, mais une chose était certaine, il avait un fils pharmacien à Pris dont il parlait toujours, c’était sa marotte[41]. En face le boulanger, dont le personnel changeait assez souvent, recevait presque quotidiennement sa visite. Lors d’un nouvel arrivant (c’était toujours un parisien) le père CEVIN lui demandait toujours s’il connaissait son garçon pharmacien. Ils répondaient tous oui, ce qui permettait à CEVIN de broder sur le thème. Il s’en allait heureux de savoir que l’ouvrier boulanger connaissait son fils. Toujours vêtu de son tablier de jardinier, il s’en allait au 81, discuter avec la mère COMMAILLE, sa voisine, laissant sa porte grande ouverte. Il se trouva qu’un jour, GAUTHEROT, le fils de l’instituteur, MARTINENGHI aujourd’hui à Etigny, et moi, à la sortie de l’école, nous avions trouvé par terre un pétard gros comme un manche de pelle. C’était un engin de guerre qui à l’époque coûtait quatre sous, une somme. Ne sachant où le poser pour le faire éclater et voyant le père CEVIN s’absenter, nous décidâmes de le poser chez lui. Pour ce faire les deux copains partirent dans la maison. Il y avait dans la pièce une maie, le dessous faisant placard, ils ouvrirent une porte et posèrent le pétard allumé sur une pile d’assiettes. Refermant le tout ils s’enfuirent. Une formidable détonation se produisit, se prolongeant par la combustion des restes du pétard. Au bruit provoqué par l’explosion, les voisins sortirent. Moi, qui me trouvait à l’angle du mur de la maison voisine, faillit être écrasé par le notaire SIMONNET en affaires chez Madame DAVID, qui sortit affolée par le bruit. La fumée qui sortait, rendait la situation plus tragique, il y eut quatre assiettes de cassées. Ce fut l’instituteur, qui comme dans le cas de la mère DRIAT, régla le sinistre en me faisant remarquer le lendemain que je m’étais tiré des flûtes[42]. Lorsque le père CEVIN fut mort, la maison fut achetée par Paul ROBINARD, maréchal qui y installa sa forge et sa femme Eugénie. Celle-ci avait l’âme commerçante, elle se mit à tuer des volailles qu’elle vendait en viande morte aux voisins. Elle allait également les jours de bals en salle, vendre des oranges aux danseurs. Continuant sur sa lancée, ce fut l’ouverture vers 1908 d’un débit de boisson qui anima la vie dans le village. Elle eut quatre filles dont les deux premières, jumelles de grande taille, attirèrent après 1910 les jeunes du pays. Le commerce s’en ressentait. Elles s’appelaient Suzanne et Laure. C’était l’époque de notre adolescence. La guerre arriva et pour tous ce fut un voile noir pendant quatre années. Le père ROBINARD ne revint pas et le fonds de maréchal fut vendu à RAIMBAULT qui alla s’installer au n° 3. La guerre finie, le cours de la vie reprit et le café prospéra. Les filles avaient grandi. Laure était devenue institutrice et je me souviens d’un soir de juin 1919 où j’étais encore affecté à la manutention de Saint Clément, elle revenait à bicyclette de la Chapelle-sur-Oreuse, où elle était en poste. C’était un samedi où une violente bagarre venait d’éclater à l’intérieur de la cour entre français et algériens. L’intendant fit appel à la troupe pour rétablir l’ordre. Le combat casse avant l’arrivée de celle-ci. Cela se solda par quatre morts dont un français, et de nombreux blessés. Jamais la presse n’en fit mention, même pendant la guerre, je n’eus aussi peur. Les mares n’étaient pas des fusils. Cela resta dans sa mémoire et la mienne, et nous en reparlions souvent.
A Egriselles heureusement la vie était plus joyeuse et s’il y avait bagarre, elles étaient plus joyeuses. Il y en eut de nombreuses et pour donner le ton je ne résiste pas à l’envie de vous en décrire une. Laure avait un petit chien blanc qui il faut le dire, fut acteur imprévu dans l’évènement. Un dimanche soir à la suite d’altercations, naquit une bousculade joyeuse entre différents clients auquel se trouva mêlé ce client que l’on devait appeler Monsieur[43]. Il arriva que Tafa le chien de Laure mordit le dit client qui vexé à juste titre, pour se venger poursuivit le chien pour jusqu’à la chambre à coucher. Le chien se réfugia sous le lit. Voyant du blanc sous le lit et savourant sa vengeance, le Monsieur en question, se mit en devoir de s’en saisir par la peau du dos. Mais hélas, il y eut erreur, ce n’était pas Tafa, c’était Jules[44] et conséquence de ce quiproquo, le bout de manchette en pleura. Vous voyer le tableau. Des histoires de ce cru, il faudrait un cahier pour les raconter. A cette époque Clochemerle[45] n’était pas né.
Reprenant le déroulement de l’Histoire, je dirai que la mère ROBINARD céda son fonds. Il y passa différents tenanciers pour aboutir au plus célèbre DUSSOUILLIEZ, dit la Godasse. Ce fut un style différent mais pourtant pas morose. Sa femme baptisée Zoé, intelligente et commerçante, ne refusait pas les joyeux chahuts. Et il y en eut, nombreux et variés, suivant les acteurs animateurs. Son voisin le boulanger DUPIN et LHOSTE le menuisier, en furent les plus appréciés. Hélas, la passion de boire fit que leur vie en fut abrégée, ainsi que celle de leur garçon Marcel DUSSOUILLIEZ. Ce fut une page joyeuse de la vie d’Egriselles qui fut tournée, au grand regret de ceux qui la vécurent. Aujourd’hui transformée en restaurant, la maison a perdu son âme, puisse-t-elle un jour lui revenir. Le propriétaire actuel est HOURY, gendre LOISON.
84ème maison (CP n° 10) : nous allons ici changer de style, la maison à la fin du XIXème siècle, propriété DAVID, mort jeune. Je ne sais rien de sa vie mais ce devait être quelqu’un, à en juger par l’adieu que lui adressa mon oncle Simon ROER, maire de l’époque. Il parla de lui en des termes soulignant la qualité exceptionnelle de sa vie. C’était son adjoint et le discours se trouve parmi mes papiers de famille. J’ai connu Madame DAVID. Elle n’avait pas d’enfants. Sa seule compagnie était une servant, une voisine Antoinette PINSONNAT grande brune que je revois encore. Un jour discutant avec JARRY, fondateur de la coopérative agricole de stockage de Courtenay, il me dit qu’Egriselles lui rappelait d’émouvants souvenirs, lorsqu’il venait voir ses amis ROBINARDS, jeunes mariés. Ce n’était pas eux qui m’attiraient mais une voisine de ceux-ci, une grande brune au service d’une voisine. Je lui dis « Antoinette PINSONNAT ? ». Il me regarda, le souffle coupé. Il ne réalisait pas que j’ai pu connaître cette fille. Il est vrai que j’étais très jeune à l’époque.
Quand la propriétaire fut disparue, la maison devint la propriété d’Alexis GENNERAT qui quittait la ferme du Buisson de la commune de Lixy. Ne s’accommodant pas du style, il la fit entièrement rasé et reconstruire dans l’état où elle se trouve aujourd’hui. Ce fut BENARD, l’entrepreneur qui assuma le travail. Il fit ce que peu de ses collègues ont fait, il avait trente ans auparavant bâti celle qu’il fut obligé de démolir. Après GENNERAT, ce fut son gendre SADRON, qui en devint propriétaire ; plus tard ce fut un de ces fils qui vendit à la commune pour en faire le bureau de poste qu’il est actuellement. GENNERAT était le gendre de la mère FOUET (n°21). Il eut deux filles : l’aînée, femme SADRON et la seconde devint en 1920 femme BOUDIN. SADRON fut tué lors de la première guerre. Il était originaire de Villemanoche.
85ème maison (CP n° 10) : la maison de BENARD Célestin, beau-frère de LHOSTE (n°46). BENARD a eu comme maçon une vie active et bon nombre de maisons du pays portent son empreinte. Il avait à l’époque des ouvriers venus du Limousin. Je me rappelle du contremaître Léon et d’un autre LIVERNETTE, qui après la guerre de 1914, fut bistrot à Sens. Plusieurs fois par semaine, BENARD emmenait au café d’en face ses ouvriers, boire l’apéritif. Il avait des vignes qui lui fournissaient la boisson nécessaire pour ses ouvriers. Combien de fois lorsque j’eus quatorze ans, je fis les navettes domicile/vigne et le soir l’inverse au moment des vendanges. Il y avait dans ces parcelles quelques pieds de chasselas[46] et un pied de portugais bleu. Je les connaissais et à l’époque des vendanges, ils se trouvaient vierge de toute grappe. Je les avais glané à chaque passage, près de la vigne. La femme de BENARD, Fanny née BAUDOIN, était blanchisseuse. A cette époque les chemises d’homme, jupons, rideaux etc., étaient portés à la blanchisseuse et lors du retour au propriétaire, c’était un luxe de précaution pour ne pas chiffonner les vêtements. Cela me remet en mémoire une scène de jour de fête dans le film de Jacques TATI. Le campagnard, sollicité par sa jeune voisine pour lui apporter sa robe de la ville, est debout dans sa voiture à âne, tenant d’une main les renés et de l’autre, le porte manteau où est suspendue la robe mise en forme par la spécialiste. Fanny avait comme aide sa nièce, Albertine[47], sœur du joyeux compagnon et animateur, Albert LHOSTE. Comme son métier, au dessus des fourneaux l’incitait à boire, certains jours elle était émue[48], dans ce cas elle ne pouvait desserrer ses lèvres. En temps normal sa conversation n’était pas dépourvue de pertinence, elle avait des mots qui frappaient. Je me rappelle, un jour, au cours d’une période électorale comme celle que nous vivons aujourd’hui (février 1978), où les démagogues surenchérissaient à qui mieux mieux. Elle trouva ce mot que jamais je n’oubliais « Où vons-je ? ». Le reprendre aujourd’hui ne paraîtrait pas déplacer.
Après eux, la maison fut vendue à Emile MILACHON, cultivateur retraité. Son fils qui lui succéda dans sa ferme à Villebougis, fut tué au bombardement de la gare de Sens en 1940. Ce fut sa petite fille, Lucette qui devint la propriétaire et aujourd’hui son cousin germain, BERTRAND Francis, devenu maçon, lui a succédé.
86ème maison : une propriété venue d’une grande famille, la famille JUFFIN aujourd’hui décimée. Je sais que le père JUFFIN qui était, je crois un artisan, fonda en 1853, la compagnie de sapeurs pompiers dont il fut le premier chef. Il eut de nombreux enfants, au moins cinq filles. Une qui était la mère de Victor DARDE dit le gros DARDE (n°25). Une autre était mariée à un vétérinaire de Tarbes dont le nom m’échappe. Une troisième fut mariée à un inspecteur de l’enseignement PERELADA. Une quatrième restée vieille fille, Célénie. Je citerai une cinquième qui, devint Madame PICAULT et habitat la maison familiale. Je l’ai toujours connue veuve. Elle s’appelait Pauline et avait deux filles. L’aînée était employée et mariée à DESAVIS. Ils eurent une fille, Madeleine DESAVIS née en 1902. Elle devint docteur et se maria au docteur PERROS qui fut directeur de l’asile départementale de la Gironde à Cadillac-sur-Garonne. La seconde fille de Pauline, Madeleine qui fut professeur d’anglais, hérita de la maison. C’était une femme minuscule dont la volonté et la ténacité, étaient en proportion inverse de son poids. Elle mourut à 93 ans. Je ne suis pas sur qu’il y eut une sixième fille JUFFIN, mais en revanche, il y eut un garçon G. JUFFIN, marié à la sœur de mon grand père, Apolline ROGER. Il exerça à Paris la profession sans doute peu lucrative d’homme de lettre. Les dettes qu’il fit absorbèrent la totalité de son avoir ainsi que celle de sa femme. Ils eurent deux enfants, un garçon qui au cours de ses études médicales fut à tort suspecté dans une affaire louche dans laquelle il n’était pour rien. Il ne pu survivre aux soupçons et mourut miné par le chagrin. Restait une fille qui épileptique, tomba un jour dans le feu et succomba. Elle devait avoir près de cinquante ans.
Revenons à Madeleine la propriétaire, elle fit don de sa propriété à Monsieur de LEMOS, un filleul de la première guerre ; il fut médecin à Véron et hélas comme son père il fut tué à la seconde. La propriété passa à son frère, ingénieur qui en 1975 la vendit au général DURIEUX propriétaire actuel. Adossé à cette maison, une demeure basse, ont habité avant 1900 Ernest VAUDOUX et sa femme que l’on reverra. Après eux, ce fut le garde-champêtre nouvellement promu BERGEVIN un personnage spécial. La figure peu souriante il pratiquait le piston. J’aurais du dire, le cornet à piston. Les soirs d’hiver alors que la cheminée éclairait la pièce, on le voyait au bout de la table s’entraîner à faire des canards. Lorsqu’il cessait, son chien Rigollot, sur une chaise à l’autre bout, lui répondait en hurlant à la lune.
A Egriselles, à cette époque il y avait un éclairage municipal pour les jours d’hiver, c’était lui qui était chargé d’alimenter les réverbères. Aussi le voyait-on 1 heure 30 avant la nuit, l’échelle sur l’épaule et panier au bras, visiter chaque poste et échanger le récipient de la veille contre un autre rechargé et allumé. Cela flambait jusqu’à épuisement du carburant. Dans cette maison passa différents locataires, entre autre le père VERNET, ami des veillées d’hiver dans lesquelles. Il amenait la goutte, chanteur infatigable, combien de fois a-t-il poussé « le temps des cerises » follement applaudi ? Pas par sa femme, car au retour abreuvé de reproches il faisait le mort. Elle ne donnait jamais le feu vert pour ces soirées qu’il aimait tant et cependant un soir de cassage de noix elle fut violée. Un participant Marcel MANSIOT vint frapper aux volets demandant du renfort pour un vêlage difficile. Autorisation donné, le père VERNET, s’amena coiffé de son bonnet de coton, entra à la cuisine sans se soucier du vêlage et s’assit et partit à chanter un verre et une liste à portée de la main. Ce fut une soirée mémorable. Les affrontements du retour importaient peu, il vivait la soirée présente ce fut la dernière. Après le couple VERNET, ce fut vers 1930, le ménage BAIN. Il était serrurier mécanicien. Ils avaient un garçon André, la femme disparut en 1956. Lui, Omer BAIN d’un caractère changeant disparut un jour qu’il avait labouré sa vigne, assis à sa table, lisant le journal il s’affaissa, c’était fini. Par la suite la maison fut occupée par différents locataires et actuellement c’est un ménage turc travaillant aux serres qui l’occupe.
87ème maison (CP n° 2): en bordure de la propriété, le sentier conduisant à Cornant, nous arrivons à la propriété DESMEUZE long corps de bâtiment occupé par deux logements. Le premier à l’ouest occupé en 1900 par Eulalie DESMEUZE, institutrice retraitée. C’était cousine Eulalie, une femme douce, peu bruyante qui me comblait de douceurs lorsque je lui portais son lait dans une laitière émaillée marbrée bleu roi et blanc. On la reverra plus loin. Lorsqu’elle mourut, ce fut sa sœur Hortense femme NEZARD veuve de celui-ci, inspecteur d’académie qui occupa le logement. Elle-même institutrice retraitée, aimait bien les enfants, leur pardonnant beaucoup. Mes deux enfants en partant à l’école, lui portaient son lait dans la laitière et la déposaient sur la fenêtre. André le plus dissipé, ne manquait pas de tambouriner à la fenêtre au désespoir de son frère qui rendait compte à sa mère. Celle-ci lui faisant comprendre la peur qu’elle pouvait éprouver, André répliquait : « Tu penses ! Elle couche dans un placard ! ». C’était une alcôve. Famille d’intellectuelle, Madame NEZARD eut un fils qui devint doyen de la faculté de Caen. Elle avait aussi une fille professeur dans le secondaire, resta célibataire et propriétaire de tout l’immeuble.
88ème maison (CP n° 2) : le second logement était occupé avant 1900 par une autre sœur DESMEUZE, Julie qui n’enseigna pas. Femme austère, catholique, elle était comme intendante à l’église. Elle ne riait jamais, si elle n’enseigna pas, il y avait sans doute une raison. Il y a avait dans la famille un simple d’esprit du nom de Charles, dont elle fut comme une tutrice (il passa 80 ans). Il bêchait, allait aux crottes sur la route et quelque fois rencontrait des gens peu raisonnables qui le faisaient boire. Il rentrait ivre et méchant, et malgré l’ascendant qu’elle avait sur lui, elle éprouvait une certaine crainte. Elle devait être l’aînée de la famille, ce qui la désigna sans doute pour ce sacerdoce. Je pense que les frères et sœurs participaient car je ne lui connus jamais de revenus. A sa mort, très vieille, 96 ans le logement revint à sa nièce qui devint propriétaire du tout. Mademoiselle NEZARD eut comme locataires le ménage SIMONETTO Antoine, lui maçon, elle femme de ménage. Ils avaient cinq enfants. Lorsque Madame NEZARD devint invalide, les époux SIMONETTO s’en occupèrent honnêtement sans arrière pensé. Lorsqu’elle fut morte, sa fille à l’encontre de personnalités, fut reconnaissante envers ses humbles voisins et s’occupa des cinq enfants. Elle permit à tous ces jeunes d’avoir une situation, une est institutrice, tous sont placés et comme elle n’avait pas d’enfants, elle en fit ses héritiers. Ce ne sont pas des ingrats, car ils n’oublient pas de venir fleurir sa tombe, tous les ans. Il y eut dans la maison un horloger PONTIGGIA et divers locataires. MUNIER, tapissier matelassier y résida assez longtemps. Aujourd’hui c’est un ouvrier serrurier BENARD qui l’occupe.
89ème maison : la maison du père DIONNE Eugène, un couvreur et sa femme Nathalie CROU. C’était un facteur né et il ne lui sortait de la bouche des blagues. Ils vivaient de son métier et de quelques pièces de terre. Ils eurent trois enfants une fille, Marie, mariée avec D.MERCIER (n°8), coiffeur et sabotier. Une deuxième fille, Angèle est à mariée à Narcisse NARJOU à Cornant où demeure toujours sa fille, Madame veuve METAIS. Une arrière petite fille mariée à Robert GRELOT habite Serbois. Ils eurent en troisième, un fils, Maurice, qui enfant alors qu’il allait à l’école, était d’après son maître un modèle d’ordre et de propreté dans ses devoirs. De tempérament un peu délicat, il était en plus assez timide, ce qui le confronta un jour à une histoire qu’il n’avait pas voulu. Alors il devait faire sa communion, l’abbé MEAUME avait rassemblé en une retraite tous les postulants à cette cérémonie. Au cours d’une interrogation, une partie du groupe se prit à rire ce qui intrigua l’examinateur. Il questionna tous les présents, mais aucun ne voulut répondre sur ce qui avait été dit par l’un deux. Alors se tournant vers Maurice qu’il savait fort impressionnable, lui posa la question en le menaçant de l’expulser s’il ne répondait pas. Ecrasé par les conséquences du refus, il devait se sacrifier en répétant le mot maudit qui faillit se faire étrangler le pauvre curé : « il a dit que vous … ». Un mot qui a fait son chemin dans la vie, qui rimait avec communion. Le curé ne pu que dire que la séance était levée, rassemblement demain à 8 heures. Ayant grandi Monsieur DIONNE devint valet de chambre palefrenier chez le docteur SERFATI. Lorsqu’il passa le conseil de révision, il fut pris bon, service armé. Ce fut pour lui une joie immense, il redoutait la réforme. Incorporé aux chasseurs à cheval, une garnison de l’est, il fit à l’époque eux ans. Puis, mobilisé en 1914, il fut dans la défense du pays. Il avait été soldat dans la cavalerie, pour lui il avait été gâté.
A cette famille succéda J.DIOT, facteur qui avait acquis la maison. Si j’ai décris la vie des précédents avec plaisir et bonheur, je ne puis décrire la vie de celui-ci dans le même esprit. Sa femme et lui formaient un couple égoïste, parfait sans enfants, ce qui n’améliorerait pas la qualité du ménage. Lui travailleur, ici s’arrête ce qu’il y a de positif à son actif. Ce fut l’être malfaisant complet, le mensonge, la diffamation, les insinuations malfaisantes, les rapines[49], telles sont un aperçu restreint des choses où il excellait. Il est décédé, il y a une quinzaine de jours à l’age de 96 ans. Son dernier passage dans le pays fut marqué par l’accompagnement de deux personnes, ses voisins. Mes amis seraient de tout cœur avec moi pour justifier la véracité de ce jugement quand je parle de voisins, je parle de ceux qui l’ont connu comme moi. Paix à ses cendres.
90ème maison : l’ensemble de bâtiment suivant, était la propriété à la fin du XIXème de GOIS Alfred, apiculteur et vigneron. A l’ouest, un corps de bâtiment avec un atelier de charronnage, et dans une pièce de l’arrière du corps de maison, habitait à cette époque une vieille fille, Virginie BOURAT (n°68). En 1903 j’étais son jardinier le jeudi. Voyez le spécialiste, je n’avais pas dix ans ! Il y avait à la suite, l’atelier du propriétaire pour l’exploitation du produit des ruches et l’hiver confections de paniers et fabrication de la ruche à cadre. Il y avait dans l’exploitation de ces activités, ruches et vignes, un ouvrier Ernest VAUDOUX, apte à tout faire, qui devait gagner à cette époque 1.50 francs par jour. Il y a resta au moins quarante ans. Après ce fut GOIS Ernest dont la direction n’égala jamais celle de son père. Ensuite le troisième du nom, GOIS Robert qui récemment reconvertit le tout en logement. Après cet atelier aujourd’hui transformé, était le logement du charron : le ménage Hyacinthe MUZARD, ancien d’Indochine. On ne le voyait pas remuer dans son atelier, pourtant voitures, brouettes ou tombereaux se succédaient à bon rythme. Il eut une fille, Jeanne, qui mariée à un charron VERMILLET de Chaumot, leur donna un petit fils. Elle mourut jeune et le petit garçon ne passa pas vingt ans étant de santé fragile. Lorsqu’il discutait, il avait un mot fétiche, il ne pouvait prononcer plus de trois mots sans dire « sauf que » comme POLLIOT disait « en principe ». Le père MUZARD céda son fonds à un jeune, CABOURDIN, grand gars taillé à coup de serpe. Il était agrémenté d’une femme cancanière et coléreuse, véritable mégère. Nous, tous, ses voisins ne le fréquentions que pour l’indispensable mais vis à vis de son propriétaire Ernest GOIS, il y avait souvent discussion. Une mémorable entre autres ou celui-ci un peu survolté reprenait ses arguments toujours les mêmes : « pauvre dégoûtant » et celui-ci de répondre hurlant plutôt que parlant « un dégoûtant qui dégoûte ce qui est dégoûtant ». J’ourle, poussé si haut qu’une voisine en fut malade de peur.
Quand CABOURDIN s’en alla, ce fut le couple SUTER venant de Lixy qui lui succéda. Ils avaient quatre enfants. Lui, ouvrier d’une finesse de travail supérieure, ne tint pas longtemps car ouvrier excellent il n’était pas fait pour être patron. Apres ce fut le ménage HARDOIN. Lui était journalier, et l’hiver brandevinier. Elle était femme de ménage, toujours disponible et extrêmement dévouée pour tous, nous en eûmes plusieurs fois la confirmation. Elle eut deux filles. L’aînée mourut assez jeune et la deuxième se maria à MARECHAL, mécanicien à Subligny. Le père Paul HARDOUIN[50], mourut assez jeune d’un cancer. Il avait été aussi bedeau, fossoyeur et pompier.
91ème maison : la route de Cornant avec une maison propriété fin du XIXème de POYER Ambroise achetée au père BAREGE la maçon qui l’avait construit pour lui. Le père POYER venait de Bracy où il était propriétaire d’une ferme de grande valeur qu’il avait cédé à son fils Ernest, moutonnier. Il n’y avait pas de jours où la canne à la main et panier au bras, il rejoignait la ferme où il avait travaillé et peiné. Pour lui c’était un pèlerinage journalier pour ce qu’il avait aimé, hommage à la terre et à la famille. L’auteur de ces lignes en y réfléchissant s’aperçu que voici vingt cinq ans qu’il suit le même chemin. La mère POYER était une femme d’une grande douceur. Ils avaient une fille Justine, restée célibataire qui avait donné la maison à sa nièce, Juliette. Celle-ci se maria à MILEFER de Saligny. Ils vendirent la maison au ménage JACQUES maréchal, lui ouvrier compétent, courageux et dévoué. Ils eurent trois garçons et lorsque ceux-ci grandirent, la maison évolua et devint une serrurerie mécanique et un peut tout ce qui concerne le fer. Quand l’heure de la retraite sonna, ce fut la dislocation de l’ensemble et la partie serrurerie échoua dans un autre atelier, avec le fils aîné Robert. La branche maréchal survit grâce à un ouvrier réchapper de la liquidation au service DOUMEIZEL Pierre, qui lui dirigea la partie mécanique, le fonds étant devenu sa propriété. Je m’en voudrais de finir cet exposé sans parler de Madame JACQUES qui fut la cheville ouvrière de la maison, elle fut souvent à la peine qu’elle soit aujourd’hui à l’honneur. Ma femme et moi après quarante années de bon voisinage, ne pouvons que lui souhaiter une retraite heureuse. Elle l’a bien méritée.
92ème maison : à cette maison au XIXème siècle habitait le ménage HERY, lui tourneur sur bois d’une grande habilité. Ils eurent deux enfants, une fille qui avait à son mariage trois enfants suivant le cortège. Il y avait un garçon qui se maria et eut une fille. Il travaillait avec son père qui faisait un peu de tout, bois tourné, harnais pour fauchaison[51]. Il était aussi tonnelier, râteaux en bois d’une légèreté extrême. Avant que l’acacia ne gagne comme il l’a fait depuis moins de cent ans, il existait de nombreux boulinières[52] plantées par les hommes. Les arbres devenus grands alimentaient les nombreux sabotiers et fournissaient également aux charpentiers, un bois apprécié mais pour cela il fallait qu’il soit écorcé et débité vert. J’ai chez moi des chevrons plus que centenaire. Revenons au tourneur qui l’hiver venu s’en allait près des bûcherons trier dans les bouleaux, le bois approprié pour son usage. Les bois dont le pied faisait la crosse étaient mis de coté, cela servait de manche à tous les outils qu’il fabriquait. Lorsqu’ils n’avaient le galbe voulu, il montait un four où il amarrait ces manches à la demande, chauffés qu’ils étaient par un feu en dessous entretenu en conséquence. J’ai connu des gens qui n’auraient jamais vu retourner du foin autrement qu’avec une fourche. HERY père et fils étaient pompiers, le garçon était même tambour et la Saint Barbe ou le quatorze juillet était pour eux jour faste. Le garçon d’un naturel intempérant devenait quelque fois dangereux, étant pourtant jeune, je me rappelle de certaines séances plutôt dramatiques. Un jour de 14 juillet ayant beaucoup bu, il revenait gesticulant beaucoup, surexisté avec dans les mains, le sabre du jeu de l’oie que l’on pratiquait à l’époque. Sa sœur le voyant venir et connaissant ses réactions, ferma portes et fenêtres sur lesquelles il buta. Le dit Emile projeta le sabre d’un geste violent à travers la porte vitrée et celui-ci se piqua dans le parquet. Alors, la sœur à l’intérieur se précipita dessus et s’enfuit par derrière pour aller le jeter dans le puit commun bordant la route de Cornant. Il ne fut jamais remonté.
Une autre anecdote, plutôt guignolesque dans le coin. Faisant son ménage, une femme, un jour de la fenêtre de sa chambre à coucher, eut la vue attirée par deux empreintes jumelles incrustées dans l’herbe ce qui impliquait vu la forme une présence humaine renouvelée. Après enquête avec son mari, il s’avéra que les volets clos, se trouvaient à bonne hauteur, un point d’observation pour un œil indiscret, qui pouvait alors violer ce temple de la femme qu’est sa chambre à coucher. La réplique fut à la mesure de l’indignation. Le spectateur privilégié eut droit à une douche hautement parfumée, ce qui en ces journées chaudes où la nature généreuse exalte toutes ses senteurs si variées. Ce purin fut sans doute bénéfique au receveur. Je crois que le maire de l’époque en eu vent et qu’il pourrait en parler savamment.
Il arriva que le père HERY fût contraint de vendre sa maison, ce fut Ernest VAUDOUX qui l’acheta. Il y viva avec sa femme et sa fille. Comme on l’a vu, lui travailla toute sa vie dans la famille GOIS. Sa femme couturière passa sa vie derrière sa machine à coudre. Sa fille mariée à Henri HULLIN en 1914 fut veuve avant la fin de l’année. Elle se remaria vers 1924 avec Maurice TONNELIER, ouvrier agricole puis cantonnier. Ils eurent une fille Simone, aujourd’hui habitant Sens. Quand ses parents furent disparus elle vendit la maison à son voisin, Robert JACQUES serrurier. Celui-ci la fit rénover et pour le moment est en attente d’occupation.
93ème maison : trois maisons récentes que je laisse de coté. J’arrive à l’avant dernière maison concernée par cette étude. C’était vers 1880 la maison d’Edmond MAUROUX marié à Augustine ROULIN. Jeunes mariés, ils furent invités par des amis où ils n’étaient pas seuls. Après le repas l’ambiance aidant, on se mit à danser et on arriva à danser la danse à TARTEMPION. Pour les néophytes, je dirai que l’on choque le postérieur contre un autre à qui mieux mieux en chantant pour s’entraîner des paroles de circonstances. Par la suite ils racontèrent cette joyeuse journée et ils héritèrent de ce surnom « TARTEMPION ». Une dynastie était née et elle vient seulement de s’éteindre par le départ à Villeneuve-sur-Yonne de la dernière petite fille mariée à MAHE, un pauvre diable. Les époux MAUROUX eurent trois garçons et une fille. Les garçons dans leur jeunesse travaillèrent à la campagne et au cours de l’été, faisaient avec leurs parents la moisson chez mes parents. Il arrivait qu’ils étaient désoeuvrés. Les relations avec la famille HERY leurs voisins à l’époque, donnaient lieu à de fréquentes bourrasques. Après de fortes engueulades ou bousculade, c’était la visite aux gendarmes où à tour de rôles ils venaient portés plainte. Cela pouvait durer deux jours. Les gendarmes parfois obsédés les recevaient vertement. Par la suite, il ne resta que la fille Lucienne qui se maria à un gars de Domats, E. ROCHE. celui-ci comme le père MAUROUX n’eut jamais qu’à obéir. Ils eurent trois enfants dont l’aînée Marcelle, mariée jeune à CHEVALLIER eut six filles qui furent élevées dans un autre style que celui pratiquait à la maison mère. Pour les deux autres, je ne décrirais pas leur pedigree, je trouve cela superflu. Je pourrai parler de la mort du père MAUROUX, homme travailleur et calme qui après un bon repas provoqué par des parisiens en goguette, se trouva gêné par un indigestion. Ils lui firent prendre une purge, peu d’heures après il était mort. La maison fut vendue voici trois ans à un employé d’E.D.F, habitant Fontainebleau qui vient y passer ses jours de congés.
94ème maison : après avoir passer deux maisons de construction plus récente, j’en arrive à la maison qui marquait le bout du pays. Ce devait être une propriété SEVRAT, occupée jusqu’en 1902 par la famille LENOIR. Ma mémoire me rappelle seulement un garçon de seize ans. Après ce fut l’occupation par la famille HERY qui construisit le bâtiment perpendiculaire à la route pour y installer son atelier de tournage qui succédait à celui que l’on a vu au n°92. La vie professionnelle continua comme par le passé. La fille HERY, Eugénie surnommée « fille », se maria à un cantonnier Oscar ROY. Ils habitèrent différents logements et eurent je crois, huit enfants. L’ensemble de la famille n’était pas riche mais je crois honnête. Les jours de fête ne passaient pas inaperçus. Tous réunis ainsi que quelques copains la maison se trouvait largement garnie. Il était établi à ce moment que la vaisselle faisait défaut ; on pratiquait deux services et tout ceci faisait dans la gaîté. Après c’était la montée en groupe à la fête. De tous les enfants je n’en connais plus qu’une fille, Marguerite, habitant Villeneuve-sur-Yonne. J’ai l’occasion de la voir une fois par an au cimetière. Elle a cette année 81 ans. Elle se ne maria jamais. Elle fut fiancé à un cheminot qui fut tué au passage d’un tunnel aux environ de Tonnerre. Son oncle, Emile, l’homme au sabre (n°92), continua son métier de tourneur mais loin de la qualification, il ne buvait plus comme avant, mais était devenu sourd. Une anecdote de plus terminera gaiement cette rétrospective.
Nous avons dit qu’il était sourd avec les yeux exorbités et un nez cassé, voyez l’apollon. Il avait à Paron, un neveu Victor, qui un jour l’invita à la fête. Il ne fut pas à l’heure, il avait eu une panne de bicyclette. Ils se mirent à table sans lui. Lorsqu’il arriva un peu transi, ils lui servirent un potage bien chaud qu’il avalait avec difficulté ; à ce moment son neveu l’interpella par ces mots : « Tu n’as pas pu amener grand-mère ? ». Il répondit : « Penses-tu ! Elle est bien trop chaude ». Il y avait eu sans doute confusion. La logique n’était pas son fort, en voici un exemple. Un jour, un client Camille MAROIS, après 1914, lui amène une feuillette à réparer. Le travail fini, revenant chercher son bien, Camille lui demanda la facture. Il lui répondit 45 francs. Trouvant le prix élevé, Camille lui demanda le prix d’une neuve. Alors imperturbable, mon Emile répondit 40 francs, ce qui lui valut cette réponse de Camille : « je te fais cadeau de celle-ci, tu m’en feras une neuve ». Après sa mort la maison fut vendue à des parisiens, SADOINE, qui après quelques années, la revendirent à d’autres. Elle est aujourd’hui la propriété de DARRAS.
En face cette maison, qui était le bout du village, une autre résidence construite il y environ 45 ans par MARIAGE qui était facteur. Le propriétaire actuel est VIETIC, un polonais habitant Villeneuve-la-Dondagre.
C’est fini, je suis arrivé au terme d’une tâche que je m’étais imposée. L’ai-je bien accompli, ce n’est pas moi qui pourrais en juger. Je signalerai simplement que tout est sorti de ma mémoire, à part deux cas me dépassant. La grammaire et l’orthographe furent peut-être offensées, je m’en excuse. Ça fait soixante et onze ans que j’ai quitté l’école. Que ce pensum accompli en hommage à mes petits enfants, soit pour eux un gage d’amour, si vivant au sein de ma famille.
Egriselles le Bocage le 12 février 1978
Fernand DRION
*
Souhaitons à l’auteur d’avoir pris goût à la narration et que cela l’incite à continuer ; les sujets ne manquent pas ! S’il veut se lancer dans l’anecdote, je lui fournis le premier sujet, l’histoire de la patte à la dinde. Et il y en a d’autres ! En tout cas ce premier essai nous a fait connaître Egriselles comme nous ne le connaissions pas. C'est-à-dire « avant nous ». Cela nous le fera sans doute aimer un peu plus et je pense que cette idée rendra papa heureux.
Avec toute mon affection.
Maryvonne DRION
[1] Fût debout de 220 litres
[2] Machine à vapeur
[3] Conducteur des attelages de chevaux
[4] Fabriquant et réparateur de harnais
[5] Séparation des filles et des garçons
[6] Fabriquant de matériel roulant tiré les chevaux
[7] Sorte de bureau administratif, ex : laisser passez pour le transport de marchandises
[8] Jusqu’en 1992
[9] En retraite en 2000
[10] Propriétaire actuel : BAUDOIN André
[11] Surnommé Santonge
[12] Depuis 2000 c’est devenue une pharmacie
[13] Fabriquant de panniers
[14] Aujourd’hui ces boutiques sont des maisons d’habitation
[15] Usine de plastique
[16] Celui qui sonnait les cloches
[17] Détruit par la tempête de 1999
[18] L’entreprise MOULINEX
[19] Fourrure de jeune agneau à poil frisé
[20] Baptisé par son grand-père, Paul BARON, « Trompe la mort »
[21] Disposant d’une salle de bains, mais n’en ayant pas besoin, elles ont fait muré la porte
[22] en argot « Merde »
[23] Aujourd’hui propriété de Agnès LESNE
[24] Aujourd’hui c’est sa fille Françoise qui l’habite
[25] Pierre et Octave PRIMAULT ont eu tous les deux la jambe cassée
[26] Décédé, et acheté par la coiffeuse
[27] Senéclause, vin blanc importé d’Algérie
[28] Surnommée « Gousse d’ail »
[29] Autre branche de Gois, rien à voir avec le maire
[30] L’orléanaise
[31] Régiment allemand
[32] De 4 mètres agrandissant le virage
[33] En francs
[34] Dans le Pas-de-Calais
[35] Surnom des soldats
[36] Elle ramassait des cailloux dans les champs après la moisson et les vendait à la commue
[37] Soit 62 grammes
[38] Le paquet de gris soit 40 grammes
[39] Une sorte de trique d’environ 1m25
[40] Sorte d’intérimaire d’aujourd’hui
[41] Idée fixe, manie
[42] Il est parti voyant que ça tournait mal
[43] Le père GOIS Ernest
[44] On appelait Jules le pot de chambre
[45] Pays viticole en Saône et Loire, où un livre a été écrit sur les nombreuses histoires de ce village
[46] Variété de raisin
[47] Surnommée « Chien de carton » en raison de son manque d’éloquence, ne parlant jamais
[48] Saoule
[49] Les vols
[50] Faisait de la goutte voir anecdote
[51] Outil sur la fau pour couper l’herbe
[52] Forêt de bouleau
 ArtisanaLife
ArtisanaLife